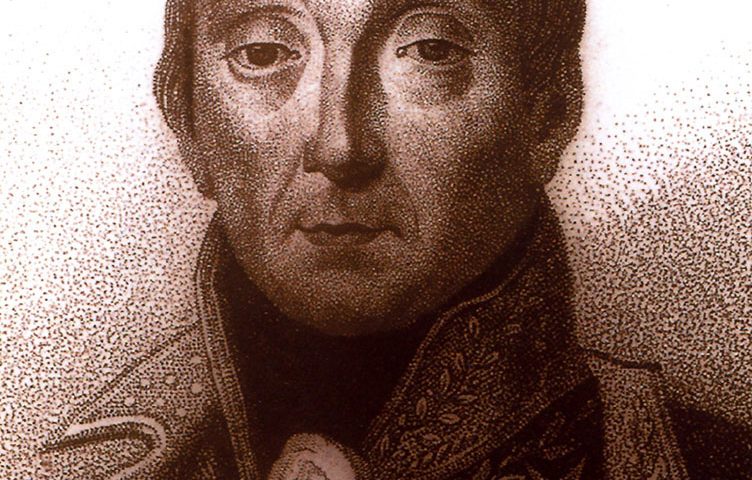Police : changement de doctrine ou effet d’annonce?

Renouveau démocratique, encore un effort
6 août 2017
La difficile réforme des aides personnelles au logement
30 août 2017Le ministre de l’Intérieur a annoncé le 16 août 2017, au détour d’une interview, une expérimentation à la fin de l’année de la « police de sécurité du quotidien » évoquée par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. Le ministre n’a précisé ni les objectifs, la stratégie et les moyens de cette police nouvelle ni ce qui est attendu de l’expérimentation, dont on ne sait si elle sera le prélude d’une réorganisation de l’action policière. Les syndicats (Etat dans l’Etat au ministère de l’Intérieur) ne devraient être consultés qu’en septembre. Le ministre n’a pas abordé spontanément la création d’une telle police lors de son audition devant la Commission des lois de l’Assemblée nationale, en juillet dernier, qui portait sur les priorités de la politique de sécurité. Il a toutefois répondu à une question sur le sujet en indiquant qu’il fallait libérer les policiers de tâches indues et de procédures administratives trop lourdes pour qu’ils soient davantage « sur le terrain », définition un peu courte de la police de proximité. Le ministre agit comme s’il fallait bien mettre en œuvre formellement le programme présidentiel mais sans s’intéresser vraiment aux conditions de sa réussite : instituer une « police de sécurité du quotidien » ne correspond pas en effet à un simple ajustement (quand bien même cette police serait réservée à certaines zones) mais à une mutation dans la doctrine de la sécurité publique. Cette désinvolture est mauvais signe : l’échec est, peut-être ou sans doute, déjà programmé.
Si cela se produit, le nouveau président ne fera que suivre son prédécesseur. Après avoir inscrit dans son programme la création d’une « sécurité de proximité », F. Hollande n’en a rien fait. Il est vrai qu’il a nommé ministre de l’Intérieur Manuel Valls, partisan sans état d’âme d’une police d’intervention, ce que semble être aussi Gérard Collomb. Dans un article de la Revue française de sciences politiques portant précisément sur ce qu’il appelle l’échec de la police de proximité mise en place en France de 1997 à 2002[1], le sociologue Sébastian Roché souligne que le choix des politiques et surtout des quelques hauts fonctionnaires chargés de préparer une réforme est déterminant pour son succès ou son échec : dès lors, dit-il, que les acteurs politiques ne savent pas très fermement ce qu’ils veulent, qu’il existe des antagonismes entre les experts sur les finalités et les moyens d’une réforme et que l’opinion publique ne s’y intéresse pas (ces conditions, réunies à la fin des années 90, le sont encore aujourd’hui), le projet court des risques.
Avant de mettre en place une police de sécurité quotidienne, il faudrait d’abord établir un bilan de 15 ans de « police d’intervention » puis répondre aux objections couramment répandues : une telle police ne serait pas une « vraie police » et n’aurait pas d’efficacité. Il faudrait ensuite préciser le projet et apporter des réponses à plusieurs questions clefs.
Sécurité publique : 15 ans de « police d’intervention », quel bilan ?
Sur les questions de sécurité, le programme d’Emmanuel Macron s’ouvrait sur un bilan net : il existe sur le territoire des zones de forte insécurité liées à une délinquance du quotidien ; le lien de la police avec la population a disparu ; enfin, même si 78 % des Français déclarent avoir confiance dans la police, les policiers n’ont pas le sentiment d’être respectés, tandis qu’une frange de la population, notamment dans les quartiers sensibles, se plaint de comportements irrespectueux de la part des policiers.
Ce bilan se vérifie d’abord sur les chiffres de la délinquance. Si surprenant que cela paraisse, il est difficile de connaître leur évolution sur le long terme, seule manière pourtant de mesurer des tendances lourdes : ce n’est que depuis 2014, date de création d’un service statistique digne de ce nom, que les chiffres produits par le ministère de l’Intérieur ne sont plus mis en cause pour tripatouillage. Ceux-ci toutefois ne mesurent pas la réalité : pour les délits de gravité faible ou moyenne (vols, cambriolages, violences sans blessure grave), un pourcentage important de victimes ne porte pas plainte. Les enquêtes déclaratives de victimation[2] diligentées par l’Insee sont alors beaucoup plus fiables, mais ne datent que de 2007. Toutefois, l’Observatoire scientifique du crime et de la justice a tenté d’établir des séries longues, révélatrices malgré des incertitudes. Il en ressort que les violences graves (homicides, agressions) sont de faible niveau et n’augmentent pas sur le long terme. En revanche, les agressions non physiques (vol à l’arraché, menaces, racket) ont augmenté fortement depuis le milieu des années 2000 (l’évolution récente est moins nette), de même que les cambriolages, à la hausse depuis 2004-2005, comme les détournements bancaires. Les chiffres concernant ces « délits du quotidien » sont toujours beaucoup plus élevés dans les grandes villes et les quartiers difficiles. Quant au sentiment d’insécurité, très important dans les transports, beaucoup moins à domicile, il reste stable depuis des années, sachant que la moyenne est malgré tout peu significative : ce sont les femmes et les personnes âgées qui l’éprouvent le plus (les femmes n’ont pas tout à fait tort, elles sont surreprésentées dans les victimes de violences hors et intra ménages) ainsi que les habitants des grandes villes et des quartiers difficiles. D’une manière générale, les criminologues reconnaissent que les classes défavorisées sont bien plus exposées que les autres : les violences, les infractions à la législation sur les drogues, l’étalage au grand jour des trafics sont bien plus répandus dans certains départements ou quartiers.
La conclusion vient d’elle-même : la délinquance qui a augmenté est celle qui touche les gens dans leur vie quotidienne. Compter les homicides à Marseille ne suffit pas à établir un bilan : ce qui rend la vie des personnes difficiles, ce sont les incivilités, le racket, la vue des trafics, les cambriolages, la violence « expressive » (destinée à faire peur). C’est ce bilan qui justifie l’analyse du criminologue Philippe Robert quand il critique les faibles performances de l’appareil policier dans la protection des citoyens, avec des taux d’élucidation très faibles sur la délinquance qui les touche : la police, dit-il, répond à côté de la plaque. Ce qui nous manque le plus, dit-il, c’est une police de sécurité du quotidien[3]. C’est exactement ce que dit le programme d’Emmanuel Macron mais pas, hélas, son ministre.
Quant aux relations entre la population et la police, chacun constate la déchirure, y compris les policiers, comme en témoignaient leurs plaintes lors des manifestations d’octobre 2016. Certes, une proportion importante de la population a une bonne opinion de la police mais, comme le remarque le sociologue Christian Mouhanna[4], c’est celle qui n’a jamais ou rarement affaire à elle et n’a pas de demande particulière à formuler à son endroit. Plus on est jeune, plus on habite un quartier excentré considéré comme difficile, plus on appartient à une minorité visible, moins on apprécie la police, ne serait-ce qu’à cause du harcèlement des contrôles répétitifs. Cette minorité critique a pourtant des attentes à son égard : elle souhaiterait que la police soit plus efficace et qu’elle apporte des réponses plus adaptées que la multiplication des contrôles. La population exprime un besoin d’ordre tout en mettant en cause les modalités d’intervention et les comportements de la police dans les territoires difficiles et pauvres où elle est amenée à agir.
La police de proximité : quelle doctrine ? Quelle efficacité ?
Percevoir la nécessité d’un changement dans les pratiques policières ne suffit pas pour construire une stratégie de rechange : les présentations hagiographiques de la police de proximité ne sont guère éclairantes et mille difficultés apparaissent quand on réfléchit à sa mise en œuvre.
Les détracteurs de la police de proximité soutiennent qu’elle serait mal définie, en tout cas ne serait pas une vraie police : il est vrai que la définition est floue dès que l’on quitte les finalités (coopérer, construire la confiance…). On assimile souvent cette police à l’ilotage, avec des policiers qui patrouillent dans un secteur qu’ils connaissent et parlent à la population pour connaître ses besoins : de fait, telle est bien la mission des « Brigades territoriales de contact » en cours d’expérimentation dans la gendarmerie, qui sont déchargées de missions judiciaires et se consacrent à la surveillance et au contact. D’où les critiques sur une police qui ne cherche qu’à être visible et à améliorer son image mais qui ne poursuit plus les délinquants et ressemble à des travailleurs sociaux.
Quant au bilan de la mise en place de la police de proximité dans les années 1997-2002, il est mitigé : Sébastian Roché note que dans certaines zones, des effets positifs ont été constatés sur le sentiment de sécurité mais qu’il n’y a pas eu d’effets sur la délinquance. Il impute ce qu’il considère comme un échec à l’absence d’objectifs clairs (il faudrait choisir entre réduire la délinquance et rétablir la confiance avec la population), à l’hostilité de la hiérarchie policière, à la faible modification des pratiques, la police s’étant davantage rapprochée des partenaires institutionnels que de la population[5]. On peut ajouter le manque de moyens et de temps laissé à la réforme, les expériences étrangères montrant qu’il faut des années pour installer une police de proximité[6]. Les UTEQ (unités territoriales de quartiers), créées en 2008, héritières non reconnues comme telles de la police de proximité, ont fait à l’inverse l’objet, en 2010, d’une évaluation plutôt positive de l’Inspection générale de la police nationale, sans pour autant avoir fait baisser la délinquance : l’expérience a été arrêtée pour des raisons budgétaires et idéologiques, ces unités ayant été remplacées par des brigades plus musclées.
Ce difficile passé de la police de proximité en France devrait conduire à prendre son temps pour élaborer le projet d’une police de sécurité du quotidien, en associant tous les acteurs dans cette réflexion et en s’appuyant sur les expériences étrangères : de fait, la France est plutôt un cas isolé dans tout un ensemble de pays (Grande-Bretagne, Québec, Allemagne, Belgique…) qui disposent d’une police de quartiers, et qui en tirent tous un bilan positif, le Québec se vantant même d’une baisse spectaculaire de la criminalité, après, il est vrai, des années d’effort[7].
Les questions à se poser sont alors les suivantes :
1° Quel lien instituer entre police de proximité, interpellation et répression ? Créer des brigades d’ilotiers uniquement vouées à la prévention et au contact est risqué : le travail étant peu prestigieux, l’on manquera de volontaires, même si l’on ajoute à leur mission celle de récolter des renseignements ; de plus, si, dans les quartiers sensibles, l’on choisit de faire coexister la BAC et des policiers ilotiers, la démarche sera démonétisée ; enfin, comme l’indique F. Ouqueteau[8], pour apaiser un quartier, il faut certes construire la sécurité en partenariat avec les familles et les acteurs sociaux mais aussi, à un moment donné, éliminer les noyaux violents. Quand on analyse le fonctionnement de la police de proximité à Montréal, l’action policière n’est pas morcelée : la dominante est faite de patrouilles et de contacts, mais la répression s’opère parallèlement, avec les mêmes acteurs institutionnels ; comment, en France, construire cette cohérence ?
2° Faut-il réserver cette action aux quartiers sensibles ? F. Ouqueteau souligne avec malice que, en phase de démarrage, installer une police de proximité dans les zones tranquilles est plus facile que dans les zones de délinquance forte où le travail de l’ilotier témoin de comportements délictueux ou perturbateurs est particulièrement difficile. Pourtant, c’est dans ces zones qu’on attend une autre police, plus respectueuse et plus efficace aussi.
3° Quel lien avec les autorités locales et les polices municipales ? La police nationale est centralisée, alors que la police de proximité suppose de disposer de marges d’action, d’abord pour être en phase avec les politiques des élus locaux, ensuite pour s’adapter au contexte et aux problématiques locales. Et comment police nationale et élus vont-ils collaborer ?
4° Comment faire accepter cette réforme, sachant que leur culture professionnelle ne prédispose pas les policiers à valoriser la prévention ni à comprendre les demandes sociales ? Dans un article récent[9], le sociologue R. Lévy notait que les policiers se voient comme « les éboueurs » de la société, avec, comme cœur de métier, la chasse aux délinquants. La BAC, dont la tradition de brutalité est connue, est considérée comme unité d’élite…
5° Enfin, quelle formation des hommes ? Quels moyens humains et techniques ? Quel budget ?
Ces questions sont lourdes. Pour les traiter, la volonté politique doit être ferme. En même temps, les policiers de base sont las de la politique du chiffre, qui n’a jamais cessé, et cherchent à donner du sens à leur métier. Il y a là une source d’espoir, ou il y en aurait une si le ministre en charge de cette réforme colossale donnait le sentiment d’y croire un peu.
[1] Sébastian Roché, Politique et administration dans la formulation d’une politique publique, Le cas de la police de proximité, RFSP, 2009/6, vol 59
[2] Enquête annuelle Cadre de vie et sécurité, Insee
[3] L’évolution des politiques de prévention et de sécurité en France depuis les années 1980, Philippe Robert, colloque de l ‘Association française de sociologie, 2010
[4] Christian Mouhanna, Une France réconciliée avec sa police ? Métropolitiques, décembre 2015 http://www.metropolitiques.eu/Une-France-reconciliee-avec-sa.html.
[5] S. Roché, police de proximité, Seuil 2005
[6] Dominique Monjardet, La réforme des services de police de Montréal, 1994-2004, 2005
[7] Voir notamment Libération, « A Montréal, une police bien policée », 30 mars 2014 et Harald Weiss et Hervé Henrion, « La police de proximité en Allemagne », 2011, article repris par Cairn.
[8] F. Ocqueteau, Comment évaluer l’impact du travail des policiers de proximité, Erudit, Criminologie, vol 36
[9] Le Monde, 24/10/2016