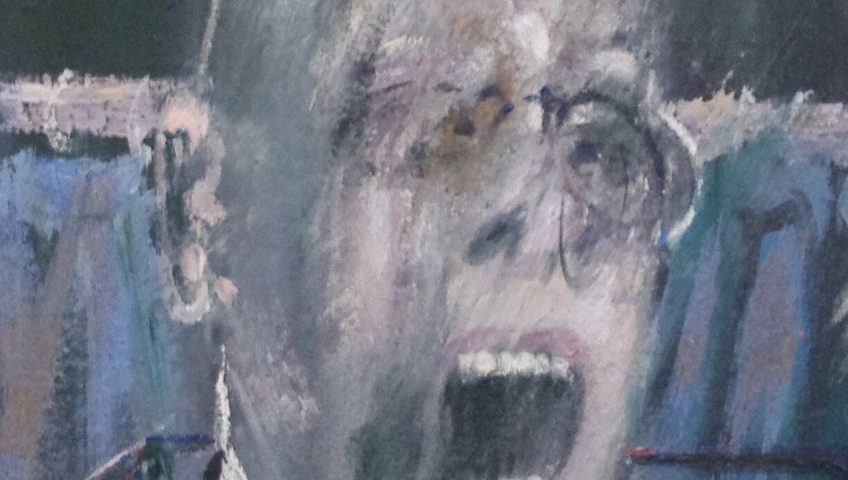Une France fracturée, malheureuse, immobile et sans pilote

B. Retailleau, le ministre qui ne croit pas aux valeurs de la République
26 mai 2025
Taxe Zucman, vrai débat, pauvre solution
23 juin 2025La période politique actuelle est, malgré son atonie, surprenante. D’un côté, la France ne parvient pas à sortir du marasme dans lequel elle s’est embourbée : la crise démocratique et institutionnelle est patente, avec un Premier ministre sans légitimité, que le Parlement garde faute de mieux, qui ne parvient ni à agir ni même à définir une ligne sur les problèmes brûlants, rééquilibrage des finances publiques, dégradation des services publics, cohérence dans la politique écologique. De l’autre, deux ans avant l’échéance, les candidatures individuelles à l’élection présidentielle se multiplient : un institut de sondage (IPSOS, Baromètre politique, mai 2025) va jusqu’à tester les chances de 14 candidats ! Ces derniers font « comme avant », comme si rien ne s’était passé, voire même ils font pire, pour exister au moins un peu, avec un discours de plus en plus simpliste et clivant. Or, le paysage politique a changé, les institutions ne paraissent plus adaptées et les questions éludées restent posées. Mais rien n’avance et, sans pilote, le pays reste dans la confusion et dans l’incertitude.
Aujourd’hui, un discours politique radical, clivant, simpliste, qui parfois brouille les repères.
Lors de sa campagne de 2007, N. Sarkozy voulait saturer l’espace public de ses initiatives, un peu comme Trump submerge l’opinion de déclarations fracassantes incessantes auxquelles il est impossible de répondre. En France, après L. Wauquier (assimiler l’état de la France à la décadence de Rome, limiter le RSA à 2 ans, accuser l’université Lyon II de dérive islamo-gauchiste, enfermer les étrangers expulsables à Saint-Pierre-et-Miquelon), G. Darmanin utilise avec plus de succès la même technique, en rafales (réprimer l’éco-terrorisme, instituer des peines minimales dès la première infraction, faire payer des frais de séjour aux détenus, révoquer le sursis pénal), tout comme B. Retailleau (un état de droit ni intangible ni sacré, le recours systématique à des courtes peines de prison, un droit du sol à revoir, la reconnaissance faciale dans les rues). Les propositions sont clivantes, assénées sur le ton de l’évidence comme s’il fallait tuer le débat avant même qu’il soit engagé, sans aucune question sur leur faisabilité : puisque l’islamisme inquiète, il faut interdire le voile aux fillettes de moins de 15 ans (G. Attal) ; puisque, moi, Président de région, j’ai pu faire des économies sur mon budget, il me sera très facile d’en faire sur le budget de l’État (X. Bertrand). Seuls quelques thèmes sont abordés (immigration, islam, justice, rigueur budgétaire), sans programme complet, avec des réponses présentées comme courageuses et transgressives qui reposent sur des oppositions simplistes : peines de prison ou laxisme, courageuse réduction des dépenses contre l’impôt de laisser-aller, libération des initiatives ou normes qui entravent, redressement ou déclin. Toute pensée complexe est bannie, risques d’effets pervers d’une mesure, nécessité de prendre l’avis des personnes concernées, réfutation argumentée des mesures alternatives, recours à une combinaison de solutions…
Il est vrai que cette surenchère simpliste ne date pas d’hier : qui se souvient encore des invraisemblances du programme de F. Fillon en 2017 (100 Mds d’économies, 500 000 fonctionnaires en moins, augmentation massive des reconduites à la frontière des étrangers sous OQTF) ou de celui de V. Pécresse en 2022, parfois inconstitutionnel (pas d’allocations familiales aux étrangers avant 5 ans de résidence régulière, doublement des peines pour les délits ou crimes commis dans des territoires criminogènes) et parfois irréaliste (augmentation de 10 % de tous les salaires inférieurs à 2800 € nets), ou encore de celui d’A. Hidalgo, avec le doublement des salaires des enseignants ? Les programmes ne sont pas vus comme des engagements mais comme des pétitions de principe idéologiques sur-vitaminées : le mensonge politique devient un vrai problème démocratique. Déjà Hannah Arendt évoquait, dans Vérité et Politique, la propension des hommes politiques à mentir, en distordant les faits ou en les interprétant pour les faire coller avec leur projet de transformation de la société, en s’inspirant de techniques publicitaires, convaincus qu’ils sont que l’opinion publique se forme grâce à des slogans. Mais elle soulignait aussi qu’ils disent « ce qui plait au public » et que celui-ci accepte volontiers de se laisser faire.
La surenchère aujourd’hui est certes une marque de faiblesse (c’est parce qu’il y a trop de candidats qu’ils cherchent à accrocher l’attention) mais le discours politique n’est pas que déraisonnable, il devient dangereux : il entend susciter l’indignation et la colère, en opposant sans nuances « nous » et « eux », ceux qui travaillent et ceux qui profitent, ceux qui créent des richesses et les assistés, ceux qui imposent le voile aux femmes et ceux qui les libèrent, ceux qui créent le désordre et ceux qui en souffrent, les détenus qui s’amusent pendant que le bon peuple paye, comme y invite G. Darmanin dans sa circulaire interdisant les activités « ludiques » et « provocantes » en prison : peu importe que le Conseil d’État ait annulé le texte pour excès de pouvoir, le ministre en a tiré le bénéfice politique qu’il en attendait.
Parfois, le discours tend à ajouter de la confusion et c’est souvent le cas sur l’écologie : soit on ridiculise l’adversaire (tant d’histoires pour protéger un coléoptère ou une loutre argentée dont personne ne connaissait l’existence), soit on affirme, contre l’évidence, être du bon côté mais « raisonnablement ». Plaidant la réintroduction de trois pesticides dangereux jusque-là interdits, la ministre de l’agriculture a déclaré : « Je voudrais que l’on ramène un peu de raison dans le débat […] Ce n’est pas un retour des pesticides, ce n’est pas un retour des néonicotinoïdes, c’est la possibilité d’utiliser un néonicotinoïde […] qui n’est pas comme les autres » […] Elle plaide aussi l’invraisemblance des accusations : « Comment les agriculteurs pourraient-ils être contre la nature alors que c’est leur outil de travail ? ». Puis, au moment même où elle montre sa totale indifférence à la science : « Moi, je ne crois qu’au discours des scientifiques », aidée, il est vrai, par une Agence européenne qui « s’interroge » sur la neurotoxicité des produits controversés, avertit d’en limiter l’utilisation mais refuse d’aller plus loin.
Les repères se brouillent aussi par l’utilisation systématique de mots nobles dont, en réalité, la signification devient ambiguë. Les discours publics regorgent de références à l’ordre, aux valeurs de la République, à la laïcité, au dialogue, termes ambivalents qui ne sont jamais définis. La sémiologue C. Alduy se moque ainsi d’une déclaration d’E. Borne tirant le bilan d’une réunion avec les organisations syndicales sur la réforme des retraites où elle n’avait aucunement la volonté de négocier : « Je n’envisage pas d’avancer sans les partenaires sociaux. J’ai entendu leur désaccord et j’ai pu leur redire ma conviction que c’est une bonne réforme ». C. Alduy parle alors « d’une langue morte, d’une langue qui tourne à vide, loin des préoccupations sociales, d’une langue qui esquive et ne veut pas écouter ». Au-delà, la seule conviction qui compte est financière. La réforme des retraites rétablit l’équilibre, donc elle est bonne, c’est le seul slogan, les détails de son contenu sont trop techniques pour qu’on s’y intéresse.
Cette transformation du discours politique est d’autant plus inquiétante qu’elle s’accompagne d’une évolution des canaux d’information (les réseaux sociaux institutionnalisent l’anecdote, la parole brève et scandaleuse, le clash) et d’une mutation de la presse. S’est créée en France, depuis quelques années, souvent avec le soutien d’industriels riches qui veulent promouvoir leurs idées, une multitude de médias d’extrême droite qui fonctionnent en réseau, se reçoivent, s’épaulent, prolongent en écho telle ou telle attaque : C-News, le JDD, Europe 1, Causeur, Frontières, sites internet divers…pilonnent l’opinion de contre-vérités énoncées comme des évidences et de moqueries contre les élites et « la bien-pensance », font la promotion d’idées « alternatives » (Trump ou Poutine) et dézinguent à tout-va le wokisme, l’Europe, l’immigration…Les chaines se présentent comme contribuant au pluralisme mais le débat y est proscrit, la parole venimeuse, les problèmes présentés de manière binaire et la répétition permanente des arguments tend à saper l’esprit critique des auditeurs.
L’opinion publique suit…mais sans doute moins qu’on ne le croit
Les sondages montrent que l’opinion publique n’est pas choquée par ces débats, voire les conforte. Dans le baromètre politique de l’IPSOS (mai 2025), Bruno Retailleau est le meilleur ministre (38 %) devant G. Darmanin (34 %) et R. Dati (17 %), ce qui ressemble à une prime à la parole clivante ou à l’esbroufe creuse. Les premiers classés parmi les prétendants à l’élection présidentielle (de 34 à 25 % de positionnements favorables) ont tous participé à la surenchère droitière évoquée plus haut, même E. Philippe (retour des peines planchers, enfermement immédiat dès la première infraction avec de courtes peines, suppression des juges d’application des peines…).
Les enquêtes d’opinion démontrent de longue date une adhésion aux thèmes favoris de la droite et du centre : il y a trop d’étrangers en France (Fractures françaises, 2024) ; l’Islam est une menace pour la France (70 %, récent sondage du Service d’information du gouvernement) ; la société est de plus en plus violente (91 %) et il faudrait rétablir la peine de mort (51 % d’opinions favorables dans Fractures françaises 2024), la justice est laxiste (69 % Baromètre de la Confiance politique, 2024), il faut supprimer l’excuse de minorité (73 %, même enquête), on devrait envoyer l’armée dans certains quartiers (73 %, ibid.), il y a trop d’assistanat (56 % ibid.) et les chômeurs pourraient trouver du travail s’ils en cherchaient vraiment (59%, ibid.).
Ce constat n’est pas anormal. L’opinion publique est souvent scrutée, au regard des enquêtes et des sondages, pour savoir si elle adhère ou pas aux choix qui lui sont présentés, y compris les formules choc (« Immigration, chance ou pas ? », « La société française, violente ou pas ? » « Le RN, dangereux ou pas pour le pays ? »), comme si elle était une sorte de juge de paix qui pouvait départager les prises de position politiques. Mais l’opinion publique ne vit pas sur une île. L’avis des personnes interrogées reflètent les discours qu’ils entendent. Ces derniers visent à les convaincre et il est naturel qu’ils y parviennent, y compris lorsqu’ils veulent susciter des passions tristes, haine de l’étranger, déshumanisation du condamné, indifférence à la souffrance de civils soumis à la barbarie. Comme le disait le philologue V. Klemperer (La langue du IIIe Reich, 1947), « les mots peuvent être de minuscules doses d’arsenic, on les avale sans prendre garde, elles semblent ne faire aucun effet et voilà qu’après quelque temps l’effet toxique se fait sentir ». Même quand il est haineux et clivant, le discours politique fait évoluer l’opinion (le politiste V. Tiberj démontrait déjà, en 2013, dans Droitisation en Europe, enquête sur une tendance controversée, qu’il a une forte influence sur les opinions et les votes, surtout quand il est univoque et que personne ne porte la contradiction) et, en réponse, l’opinion publique légitime le discours public.
Pourtant, à y regarder de près, la réalité est moins simple : l’opinion publique infléchit fréquemment son propre positionnement, voire se contredit. Dans Fractures françaises 2024, l’immigration (déplorée quelques pages auparavant comme excessive) est reconnue comme une nécessité et les répondants jugent que réduire le nombre d’immigrés en France n’aurait pas de conséquences sur le chômage en France. L’opinion varie d’ailleurs selon que l’immigration est accolée ou non au travail. Selon Fractures françaises, les personnes interrogées, alors même qu’elles en ont repris le programme, voient le Rassemblement national, à 50 %, comme un danger et à 54 % comme attisant la violence (il en est de même pour LFI). Enfin, le racisme est reconnu comme élevé en France (à 85 %), reconnaissance qui témoigne implicitement d’un rejet. Dans Le baromètre de la confiance politique 2024, les étrangers sont trop nombreux mais 49 % des personnes interrogées pensent qu’il faudrait évoluer vers un modèle pluriculturel où chaque communauté pourrait affirmer son identité. L’assistanat est condamné mais les Français adhèrent massivement à l’idée que, pour que les pauvres ne le soient plus, il faudrait davantage prendre aux riches. Enfin, dans une enquête de l’UNEDIC de novembre 2024 sur le chômage, 95 % des répondants considèrent que tout le monde peut être frappé et 75 % que le chômage est subi et non pas choisi. Pourtant, 37 % des Français expliquent le chômage par le refus du travail, 25 % par la fraude, 24 % par le montant excessif des allocations (soit plus de 80 % qui mettent en cause le demandeur d’emploi). Pour éclairer ces contradictions, l’UNEDIC rappelle les conclusions d’une étude d’universitaires suédois : les personnes savent que le chômage est imputable à l’économie mais elles veulent croire dans le mérite et elles tentent de concilier les deux.
Il faut donc sans doute être prudent dans la mesure de l’adhésion du public. L’on a ainsi souvent souligné l’indéniable recul de l’environnement dans la liste des préoccupations des Français, qui s’en préoccupent deux fois moins aujourd’hui que du pouvoir d’achat ou de la santé. Pourtant, parallèlement, quand la question porte directement sur l’enjeu climatique, une majorité écrasante le juge essentiel et urgent et attend des réponses de l’État et des entreprises.
Pour décider de l’avenir, la période écoulée mériterait pourtant un vrai bilan
La France est d’abord marquée par l’échec du macronisme. Caractérisé par un style (un souverain qui installe une verticalité méprisante et qui ne supporte pas les contre-pouvoirs), par une pensée libérale qui s’apparente au saint-simonisme du XIXe siècle (l’État s’identifie aux intérêts des producteurs dans une société sans clivages dont la priorité est de soutenir l’ économie), le macronisme est aujourd’hui dévalorisé pour son élitisme social, sa pratique de l’autorité solitaire, sa politique pro-riches, son échec à améliorer les finances publiques et la fragilité de ses résultats économiques. La dissolution de l’Assemblée nationale décidée sur un coup de tête orgueilleux a suscité la colère. Même si, à titre personnel, E. Macron parviendra sans doute à reconstituer une image honorable, sa conception du pouvoir est rejetée, ce dont témoigne l’édition 2024 de Fractures françaises : en 2 ans, la confiance envers les députés a baissé de 36 à 22 %, celle envers le Président de 41 à 26 %. Les élus sont jugés davantage corrompus (63 % au lieu de 57 %), intéressés par leurs intérêts personnels et non pas par celui des Français (83 % contre 71 %). 78 % des Français (contre 67 % deux ans auparavant) jugent que la démocratie fonctionne mal et ne se sentent pas représentés. En décembre 2024, le sondage Harris interactive montre le refus à 61 % que le Président de la République ait une majorité absolue dans d’éventuelles nouvelles élections législatives.
Deuxième constat, la question sociale est bien présente, même si on ne l’a guère évoquée ces deniers temps que par le prisme de l’inflation. Le baromètre État de la France, réalisé en novembre 2024 par IPSOS pour le Conseil économique, social et environnemental, traite de la perception des inégalités : loin des seules inégalités de revenus (pourtant prégnantes, 13 % des personnes ne parvenant pas à couvrir leurs besoins essentiels et 32 % tout juste), les réponses évoquent le logement, l’accès aux soins, l’accès à l’emploi. Elles associent les inégalités à des causes multiples, différences salariales indues entre les métiers, discriminations, difficulté d’accès aux services publics, inégalités territoriales, faible efficacité de la redistribution. Certains des répondants (un quart de la population) se sentent lésés, mis à l’écart et réclament d’agir sur le pouvoir d’achat, mais aussi sur les institutions et la gouvernance, la protection sociale et les services publics. La revendication est globale : les personnes ont compris qu’elles ne sont pas simplement pénalisées par l’insuffisance de leurs revenus. Elles mettent en cause l’efficacité et l’équité de l’action publique.
De même, analysant dans son ouvrage Les racines sociales de la violence politique (L’aube, 2024), le politologue L. Rouban évoque la difficulté, voire l’incapacité, de notre système démocratique à traduire et à traiter la violence, cette « maladie sociale » qui selon lui s’amplifie[1] (à la fois dans les actes et dans les discours) mais qui change de nature et ne s’inscrit pas toujours dans un cadre idéologique. S’agissant tout particulièrement du mouvement des Gilets jaunes, il en voit la source moins dans des émotions (telle la colère) que dans le refus de l’injustice, sentiment de déclassement et difficultés financières incessantes d’un côté, concentration excessive des pouvoirs économiques et politiques de l’autre. Selon lui, le mouvement, qui dénonce l’hypocrisie d’une prétendue « méritocratie », est moins une demande d’égalité que de meilleure équité, avec une demande de changement des règles sociales.
Troisième élément du bilan, le tripartisme de l’Assemblée nationale, qui était en gestation depuis des années, s’est installé et risque de durer. Le présidentialisme tel qu’il était, qui a besoin d’une majorité absolue à l’Assemblée pour s’exercer pleinement, devra s’adapter. Comment ? Quelle répartition des pouvoirs ? On ne sait trop. Tout le monde semble penser la situation actuelle comme provisoire, avec un retour à un pouvoir fort en 2027. Mais rien ne l’assure et c’est même le contraire qui est le plus probable.
Or, le pouvoir ne peut se recentrer, au moins pour une part, sur l’Assemblée nationale que s’il existe des alliances et des coalitions solides décidées à gouverner. De telles coalitions se construisent sur un programme de gouvernement : ce peut être l’occasion de sortir des slogans et des petites phrases clivantes, de construire des politiques sur les préoccupations essentielles, la sécurité, la justice, l’immigration, l’environnement, les finances publiques et l’éducation, avec l’espoir de choix réfléchis. Mais rien ne se passe de tel et le pays attend les échéances politiques prochaines sans les préparer.
Qu’est-ce qui nous empêche de bouger ?
La faiblesse des partis actuels est, dans ce contexte, un lourd handicap.
Celle du Rassemblement national est patente : ce n’est pas un « vrai » parti, avec une démocratie interne et une doctrine solide, mais un « mouvement » mal dirigé, formé de sensibilités diverses, qui jusqu’ici s’est montré inapte à sélectionner et former des candidats crédibles. Les risques s’accroîtront dans les mois qui viennent compte tenu des incertitudes liées à l’avenir de Marine Le Pen, son dauphin étant contesté et, malgré les sondages, très fragile.
Les faiblesses du Parti Les Républicains (43000 adhérents en début d’année 2025, 100 000 après une campagne d’adhésion préalable à l’élection du Président), résident à la fois dans l’homogénéité sociale de sympathisants plutôt âgés et dans leur large alignement sur les thèses du Rassemblement national, sauf en ce qui concerne les dépenses publiques, qu’ils veulent sabrer sans modération. LR garde de plus l’illusion qu’il va redevenir le pôle de référence de la droite et attirera des voix sans avoir besoin de conclure d’alliances.
Les parlementaires macronistes, qui ne se sont jamais organisés en parti et n’ont jamais cherché à construire une doctrine (sauf à suivre le Président) ne savent plus où ils en sont et godillent entre la reprise de thèmes de la droite dure et quelques velléités pour s’en distinguer.
Les écologistes sont en perte de vitesse et leur dirigeante ne parvient pas à imposer sa voix dans un débat public sur l’environnement qui en aurait pourtant bien besoin. L’image de LFI est dégradée (lui aussi est un mouvement d’adhésion sans débats ni démocratie internes) et le parti socialiste ne parvient ni à approfondir sa réflexion ni à choisir des figures nouvelles pour reconstruire son identité : les politistes (De quels maux souffre le parti socialiste ? P-N. Baudot, The Conversation, 1er juin 2025) le voient comme un parti de professionnels, imprégné de social-démocratie mais incapable de donner à cette référence un contenu actualisé, investissant peu dans le travail collectif.
En définitive, le pays est dans une situation d’atonie et de blocage et n’anticipe pas. Pourtant, des décisions l’attendent : il ne va pas être possible de construire le budget 2026 sur le pauvre modèle de 2025, sans rien décider et en se laissant porter par le courant. A force de nier que l’environnement mérite une vraie politique, des calamités vont démontrer que les décideurs ont méconnu la gravité des questions à résoudre. Les inégalités territoriales et le sentiment d’exclusion de certaines populations n’ont jamais reçu de vraies réponses. Toutes les enquêtes signalent de longue date une altération ancienne et profonde du lien entre les Français et le pouvoir politique et il faudra bien s’atteler enfin à proposer des mesures pour mieux associer la population aux décisions. Là aussi, il faudra réfléchir aux choix : l’ouvrage de Luc Rouban mentionné ci-dessus soutient que, contrairement à une idée partagée, la légitimité d’une décision ne s’accroît pas en fonction de la participation des citoyens. Il insiste plutôt sur le bon fonctionnement général de la démocratie (selon lui, la démocratie participative ne fonctionne bien que si la démocratie représentative fonctionne bien aussi) et sur l’existence d’un « horizon de convergence », un projet partagé ou un cadre de référence commun qui donne du sens aux politiques publiques menées. C’est bien, effectivement, ce qui nous manque.
Pergama, le 9 juin 2025
[1] Une telle affirmation n’est pas toujours validée, certains experts soulignant que la violence a de tout temps été très présente et refusant de conclure qu’elle s’amplifie.