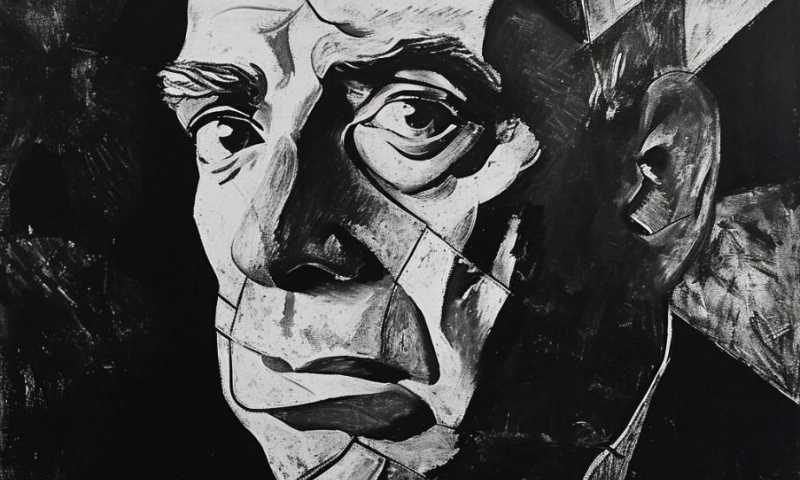Ce que la loi Duplomb dit de nous

Les services publics, absents des débats
4 août 2025
Un pays en danger
1 septembre 2025La proposition de loi Duplomb visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur a été promulguée le 11 août 2025, amputée d’une part de son article 2 qui prévoyait la possibilité de déroger par décret à l’interdiction d’utiliser certains pesticides. Cette loi marque un tournant, à plusieurs titres : après l’effacement accéléré, en avril 2024, au niveau européen, avec l’appui des représentants français du centre, de la droite et de l’extrême droite, des contraintes environnementales de la PAC (consacrer une part de la surface agricole aux jachères, aux arbres, aux mares, aux haies, organiser une rotation des cultures et maintenir des prairies permanentes), la loi Duplomb abordait tous les « totems » agricoles[1] encore non traités : outre la réintroduction des néonicotinoïdes, elle relevait les seuils à partir desquels les élevages sont soumis à autorisation environnementale ; accordait une présomption d’intérêt général aux ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation, pour faciliter leur construction ; tentait de mettre au pas l’Office français de la biodiversité, en charge d’effectuer des contrôles dans les exploitations agricoles, dont les agents sont placés désormais sous l’autorité du préfet. Ne manquait au tableau que le droit d’épandage des pesticides par drone, inscrit pour une part dans une autre loi du 23 avril 2025.
Or, pour la première fois, une pétition réclamant l’abrogation d’un texte adopté par le Parlement a recueilli plus de 2 millions de signatures. Pour la première fois, des scientifiques se sont exprimés massivement contre le retour des néonicotinoïdes et leur voix a porté.
Pourtant, la loi Duplomb, même amputée de son article-phare, constitue une alerte : elle révèle la vulnérabilité de de nos institutions aux manœuvres illégales et aux discours antiécologiques ; elle montre notre incapacité à substituer, à des solutions illusoires, un projet pour l’agriculture qui tienne la route ; enfin, elle confirme la faiblesse d’un Conseil constitutionnel incapable de sanctionner des atteintes graves à l’environnement.
Notre système résiste mal aux manœuvres des extrêmes
La loi a été adoptée le 8 juillet dernier à l’Assemblée nationale par 316 voix pour, 223 contre et 25 abstentions, à une majorité confortable qui a réuni le Rassemblement national, Les Républicains, Horizons, le Modem et Ensemble pour la République, soit l’extrême droite, la droite et le « bloc central ». Cependant, la loi n’a jamais été débattue à l’Assemblée et aucun amendement n’y a été jamais été soumis. Les partisans de la proposition de loi ont en effet proposé et obtenu un vote de rejet au début de la discussion du texte, en prétextant l’ampleur des amendements déposés par l’opposition. Ils violaient ainsi l’article 91 du règlement de l’Assemblée nationale, qui dispose que « l’objet (du vote de rejet) est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer ». Mais le rejet d’un texte par une des deux assemblées n’interrompt pas les procédures prévues à l’article 45 de la Constitution : les Présidents des deux assemblées peuvent alors convoquer, pour élaborer un texte « commun », une commission mixte paritaire, soit 7 députés et 7 sénateurs en majorité favorables au texte. La CMP a travaillé sur le seul texte voté, celui du Sénat, texte revenu ensuite au Sénat puis à l’Assemblée pour être définitivement adopté, mais sans droit d’amendement, comme le veut la Constitution. En définitive, les nuances et les réserves sur tel ou tel point n’ont jamais pu s’exprimer, la loi, jamais discutée à l’Assemblée, a été adoptée brute de décoffrage.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, le Conseil constitutionnel a toujours refusé de sanctionner de tels détournements de procédure, alors qu’ils jouent un rôle décisif dans l’adoption d’un texte, sans doute parce que prouver une telle intention est délicat : dans sa décision sur la loi Duplomb, il affirme donc que le viol du règlement intérieur de l’Assemblée échappe à son contrôle (ce texte n’a pas valeur constitutionnelle). Bien que l’article 43 de la Constitution (qui devrait fonder ses décisions) édicte que « les membres du Parlement et le gouvernement ont le droit d’amendement », bien que ce droit n’ait pas pu jouer en l’occurrence à l’Assemblée nationale, le Conseil refuse la réalité : « la loi déférée », dit-il en contradiction avec l’évidence, « a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution ». Pire, il valide à demi-mot le procédé, soulignant que le droit d’amendement ne peut s’appliquer que s’il n’en est pas fait un usage excessif, ce qui était précisément la justification des partisans du texte pour organiser un vote de rejet fallacieux. Il aurait été pourtant tout à fait possible d’encadrer le débat à l’Assemblée pour éviter la pluie d’amendements, par exemple en enserrant la discussion dans un « temps législatif programmé ».
La manœuvre a été à nouveau utilisée, quelques jours plus tard, pour adopter la proposition de loi relative à la raison impérative d’intérêt public majeur du projet de l’A 69 Castres Toulouse (loi qui tente de s’opposer à une décision de justice) puis celle sur la réforme de l’audiovisuel public. Devra-t-on s’accommoder de ces manœuvres déshonorantes, avec la complicité du Premier ministre, des présidents des deux assemblées et des membres de la CMP, qui concourent tous, en pleine conscience, à une illégalité ?
Si l’on ajoute à cette manœuvre l’adoption d’un texte caricatural présenté comme sauvant enfin une agriculture française au bord du gouffre, voté sous la menace des troupes de la FNSEA présentes sur le parvis de l’Assemblée, l’on mesure combien le vote a été empreint de lâcheté : mais quel parlementaire aurait le courage de paraître traître à cette cause si sensible, d’autant que le gouvernement s’était engagé, en 2024, pour mettre fin aux émeutes agricoles, à tout céder ? La peur de perdre l’électorat agricole au profit du Rassemblement national, l’habitude de s’aligner sur les demandes de la FNSEA joints à un manque de convictions profondes sur la nécessité de protéger l’environnement expliquent cette soumission.
Cependant, croire que la surenchère sur le Rassemblement national permettra d’affaiblir celui-ci est une illusion. La méthode du RN est, en ce domaine, habile et efficace : s’agissant de l’agriculture, il a choisi l’attaque virulente, absurdité des contraintes écologiques, offensive contre une Union européenne responsable de tout, refus du libre-échange, retour à une politique de prix des produits ; il encense surtout le retour au bon sens, celui de M. Tout le monde contre l’élite : sur le climat, « il ne faut pas être alarmiste », comme on l’est le GIEC ; la nature c’est bien beau mais ce serait stupide pour autant de mettre à mal l’économie et la production et de changer des modes de vie bien innocents : l’écologie, c’est pour les bobos déconnectés, pas pour les petites gens qui ont déjà bien du mal à s’en sortir. Une part de la population suit.
Pourtant, il existe des réticences dans les partis qui ont officiellement soutenu la loi : 24 votes contre ou abstentions sur 88 votes pour Ensemble pour la République, 10 sur 36 au Modem, 7 sur 33 à Horizons, peut-être par conviction, peut-être par lucidité. A voter constamment avec le Rassemblement national sur tous les textes de régression environnementale comme sur l’immigration, comment s’en démarquer ensuite aux élections[2] ? Comment ensuite plaider les choix que le dérèglement climatique va, tôt ou tard, imposer ? Et comment répondre aux arguments scientifiques, qui considèrent qu’en autorisant en 2024 le néonicotinoïde concerné (l’acétamipride) parce qu’il existerait prétendument des « incertitudes majeures » sur sa toxicité pour l’homme, l’autorité européenne EFSA a négligé la multiplicité des études scientifiques qui en soulignaient les risques, ce qui aurait dû inciter à une démarche de précaution ?
Qui est capable d’énoncer une politique agricole d’avenir ?
La loi Duplomb était et reste chimérique : elle n’apporte aucune réponse à la question des revenus dérisoires dont souffrent nombre d’agriculteurs, surtout dans certaines filières et qui est leur principal problème. Elle favorise en réalité les « gros », notamment l’élevage intensif et les grandes cultures irriguées. Elle ne règle pas la question de la concurrence interne à l’Europe due aux produits agricoles bas de gamme (fruits, volailles, viande pour l’essentiel) en provenance d’exploitations dont les coûts de production (ferme-usines des pays de l’est, producteurs du sud) sont imbattables.
Surtout, la tolérance sur les pesticides et les engrais va se heurter à des limites physiques : la pollution de l’eau devient préoccupante et surtout les sols se dégradent, par l’érosion (sols nus), par la « compaction » et l’imperméabilisation (grosses machines), par la persistance des pesticides et les engrais. La préoccupation est encore émergente et les études trop peu nombreuses : toutefois, selon l’European Union Soil Observatory, 60 % des sols européens sont en mauvais état. Les rendements vont baisser et l’agriculture va devoir s’engager dans une intensification coûteuse et sans fin de l’usage des produits phytosanitaires pour doper une production chancelante.
La loi Duplomb comportait également des promesses trompeuses : si la loi peut désormais attribuer le label RIIPM (reconnaissance d’une raison intérêt impératif public majeur) aux ouvrages de retenues d’eau agricoles, c’est à condition que « ces ouvrages résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers » : or, ces conditions n’ont quasiment jamais été remplies pour les ouvrages contestés. De plus, le label RIIPM n’est qu’une des conditions pour être autorisé, par dérogation, à détruire des espèces protégées : son attribution d’office est un privilège mais il ne suffit pas. De même, placer les agents de l’OFB sous l’autorité des préfets est certes une preuve de méfiance à l’égard de cet organisme, dont les contrôles (pourtant rares) sont mal supportés par les agriculteurs. Pour autant, cette mesure ne changera pas la nature de ses missions.
Cela dit, que proposer aux agriculteurs ? Pour résoudre les problèmes de revenu et de concurrence, il faudrait influer sur la PAC, redistribuer autrement les aides, durcir et uniformiser les normes environnementales (ce n’est guère dans l’air du temps), et soumettre les importations agricoles dans l’Union au respect de normes environnementales minimales, ce que l’on ne sait pas faire aujourd’hui.
Comment revenir en effet sur une politique européenne qui a encouragé la production sans mesurer qu’elle n’était pas toujours compatible avec la protection de l’environnement et du climat ? L’inversion des priorités supposerait des changements difficiles et qui sont refusés : pratiques agricoles compliquées qui restaurent les sols, limitation de l’élevage, rapprochement entre élevage et cultures, fin des immenses exploitations aux champs infinis sans bocage ni haies, modification de l’alimentation, acceptation de l’augmentation des prix. En donnant une nouvelle définition des alternatives aux pesticides (un autre produit chimique pratique et pas cher), la loi Duplomb montre combien les attentes des agriculteurs sont éloignées des propositions d’avenir portées par le souci de préserver la nature. Comment de plus faire évoluer toute une filière, des producteurs aux coopératives, de l’industrie agro-alimentaire aux acheteurs en gros, en la rassurant sur la viabilité économique de ces transformations ? La question va pourtant devenir urgente : qui sera capable d’assumer politiquement ce projet ?
Dernier enseignement de la loi, la grande tolérance du juge constitutionnel
Le premier considérant de la décision 2025-891 du 7 août 2025 du Conseil constitutionnel indique que les néonicotinoïdes ont des incidences certaines sur la biodiversité et la qualité de l’eau et présentent des risques pour la santé humaine. Ce n’est qu’en second lieu que le Conseil mentionne que la dérogation est trop large, puisqu’elle ne comporte aucune précision sur son champ d’application ni de restriction de durée. L’on pourrait être tenté d’en tirer la conclusion que, même si la dérogation avait été mieux encadrée, elle aurait été contraire au droit de chacun « de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » (article 1er de la Charte pour l’environnement).
Pour autant, si l’on se reporte à la décision 2020-809 DC du 10 décembre 2020 qui traite également d’une dérogation à l’interdiction de néonicotinoïdes, on constate que les effets du produit pour lequel était demandé une dérogation sont décrits de manière exactement identique (« Ces produits ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux ainsi que des conséquences sur la qualité de l’eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine »). Pour autant, compte tenu du fait que la dérogation était en 2020 cantonnée à une filière et encadrée dans le temps, le Conseil concluait qu’elle ne portait pas atteinte à l’article 1er de la Charte de l’environnement.
Il est donc très probable que le Conseil aurait admis la dérogation Duplomb si elle avait été mieux encadrée. Au demeurant, s’il évoque des « risques pour la santé humaine », la décision n’invoque pas le principe de précaution applicable en cas d’incertitude scientifique, pas plus d’ailleurs, s’agissant des effets reconnus comme certains sur la biodiversité, le principe de prévention évoqué par l’article 3 de la Charte. Il est vrai que compte tenu de la rédaction de cet article (« Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences »), le Conseil considère que celui-ci n’est pas utilisable pour censurer la loi.
La décision du Conseil constitutionnel n’est donc pas une grande victoire : elle n’est que la conséquence de la sottise des rédacteurs de la loi Duplomb.
S’agissant des autres dispositions de la loi, outre qu’il refuse de sanctionner le mode d’adoption de la loi (cf. ci-dessus l’analyse de ce détournement de procédure), le Conseil ne trouve rien à redire à ce que les distributeurs de produits phytosanitaires puissent jouer également un rôle de conseil. Il reconnait au législateur le droit d’élever fortement le seuil qui soumet les élevages de volailles et de porcs à une procédure d’autorisation environnementale, parce qu’il considère que cette décision ne modifie pas leurs obligations. Il refuse d’admettre que ce relèvement constitue une atteinte au principe de non-régression environnementale (« la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment »). Il est vrai que, de toute façon, il n’a jamais donné à ce principe valeur constitutionnelle bien que celui-ci soit très proche de l’article 2 de la Charte (« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement »).
Le Conseil adopte ainsi une lecture jésuitique des textes. En réalité le classement des exploitations agricoles entre celles qui sont soumises à autorisation environnementale et celles qui y échappent doit refléter les risques qu’elles représentent pour l’environnement : faire glisser des installations d’une catégorie à une autre, ce n’est pas seulement alléger les contrôles, c’est refuser de reconnaître les atteintes portées à l’environnement.
Enfin le Conseil ne s’offusque pas qu’une loi puisse accorder à un ouvrage de retenue d’eau agricole la qualification « d’intérêt général majeur » alors même qu’il existe un consensus scientifique pour exprimer de fortes réserves sur ces retenues. Il admet de même que ces ouvrages bénéficient d’une présomption de « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), qui vise à ce que les contestations qui pourraient s’élever à leur encontre au nom de l’interdiction de détruire des espèces protégées soient plus malaisées. Il est vrai toutefois que, parallèlement, il limite l’effet de ces dispositions, indiquant que la présomption de RIIPM n’est pas irréfragable (il est possible d’attaquer le décret qui l’impose pour illégalité) et que, pour obtenir une dérogation à la protection des espèces protégées, la RIIPM ne suffit pas (deux autres conditions doivent être remplies). Mais il refuse d’attaquer frontalement les qualifications de la loi, qui utilise la notion d’intérêt général pour défendre les intérêts d’une catégorie particulière.
Le risque est que l’État perde de sa légitimité pour sa partialité et parce qu’il sera soupçonné de ne pas protéger la population des risques climatiques et environnementaux qui la menacent. Inversement, le risque est aussi qu’une partie croissante de la population se persuade (on le lui serine constamment) que l’écologie ne compte pas et qu’il faut produire toujours davantage, quelles qu’en soient les conséquences. La loi Duplomb est ainsi le révélateur de nos fractures. Reste à espérer, sans trop d’illusions, que nous parviendrons à les dominer.
Pergama, le 18 août 2025
[1] Le terme « totems » est utilisé dans le rapport de la Commission des affaires économiques du Sénat, qui se réjouit de s’attaquer enfin de front aux « totems » qui « minorent notre potentiel de production agricole ».
[2] Une étude de Politico montre que dans l’année 2014-2025, Les Républicains ont voté 7 fois sur 10 comme le Rassemblement national.