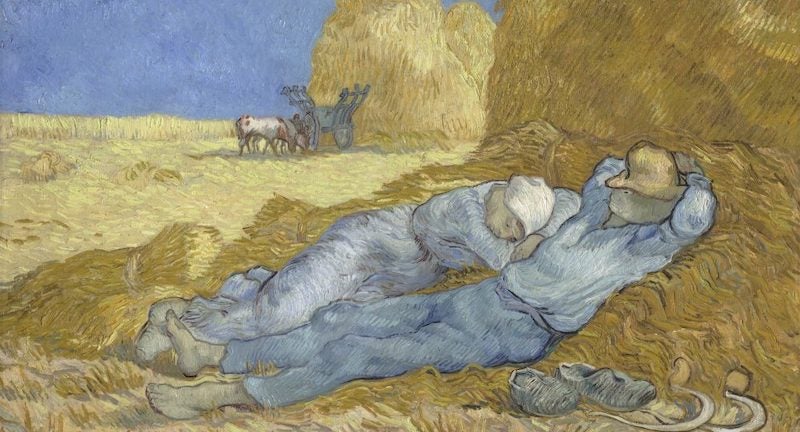Politique agricole : dominer la désespérance?

Immigration-submersion : un pur fantasme, du pur racisme
3 février 2025
L’IA, cheval de Troie trumpiste dans un monde vulnérable
3 mars 2025Peut-on encore parler du « monde agricole » comme d’un monde unitaire ? Les résultats des élections de janvier 2025 aux chambres d’agriculture témoignent de la progression de la Coordination rurale, syndicat soutenu par l’extrême-droite, qui remporterait 14 départements, soit 11 de plus qu’en 2019, bousculant la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), jusqu’alors massivement dominante. Celle-ci, qui depuis 2019 avait la main, avec son allié Les jeunes agriculteurs, sur la quasi-totalité des départements (97), en perdrait 17 mais en garderait 80. On ne connaît pas la place du troisième syndicat, la Confédération paysanne (classée à gauche et prônant l’agroécologie). Toutefois, ces résultats changent-ils quelque chose, dès lors que le gouvernement est prêt à tout pour complaire aux demandes des syndicats, même les plus déraisonnables, quitte à sacrifier l’intérêt général ? Pourtant, il existerait une voie pour agir : mais il faudrait que la classe politique s’interroge sur la représentativité des syndicats agricoles, sans doute bien plus faible qu’il n’y paraît, et engage avec les agriculteurs un dialogue plus exigeant qu’aujourd’hui pour les sortir de l’impasse dans laquelle ils s’enfoncent.
Qui représente quoi ?
15 jours après la clôture du processus électoral, il est impossible de disposer des résultats nationaux consolidés des élections aux chambres d’agriculture, pourtant présentées comme essentielles pour le monde paysan : les chambres ont pour mission de défendre les intérêts agricoles des territoires et d’accompagner les exploitants, sachant que, par ailleurs, la répartition des financements publics entre les syndicats agricoles dépend des résultats de ces élections.
Le chiffre de la participation nationale n’est pas connu à ce jour (17 février) : le ministère ne publie que le taux de participation par vote électronique, soit 29 % pour les exploitants agricoles et 4,5 % pour les salariés de production. Pourtant, certains sites évoquent une participation de 40 % « environ » pour les exploitants, alors qu’en 2019 le chiffre du vote électronique était quasiment celui de la participation finale. De même, la ventilation des votes entre les listes en présence n’est connue qu’au niveau départemental et pas au niveau national. Pourtant, le site Terre-net, géré par un groupe privé d’information spécialisé dans l’agriculture, avance (mais sur quelles bases ?) des informations : la FNSEA, qui avait obtenu en 2019 55 % des voix, en aurait désormais « moins de 50 % » et la Confédération paysanne « un peu plus de 20 % ». Est-ce sérieux ?
La structure qui coiffe au niveau national les Chambres d’agriculture publie de même la carte des départements en fonction du syndicat qui a gagné le collège des exploitants. Cependant, ces résultats ne traduisent pas la réalité des forces en présence, compte tenu du mode de répartition des sièges dans le collège, étonnamment peu démocratique : la liste arrivée en tête obtient d’office la moitié des sièges, puis les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle. De ce fait, la répartition fine des voix a peu d’importance pratique puisque e syndicat arrivé en tête, même de quelques voix, écrase absolument tous les autres : avec un tiers des votes, un syndicat arrivé en tête aura 12 sièges sur 18…En outre, une chambre d’agriculture compte 10 collèges, celui des exploitants agricoles (collège 1), mais aussi ceux des propriétaires, des salariés, des groupements agricoles, des retraités, des banques et assurances agricoles…Certes, le poids de ces collèges est inégal : le collège des exploitants élit 18 membres sur les 34 à 37 élus qui pilotent les chambres d’agriculture. Pour autant, le poids des autres collèges compte, malgré une participation souvent extrêmement faible. Dans la pratique, les réseaux établis de longue date dans les différents collèges favorisent la domination traditionnelle de la FNSEA.
En définitive, qui représente les 404 000 exploitants agricoles ? Officiellement, ce sera toujours la FNSEA, qui représente sans doute entre 15 à 20 % des exploitants tout en faisant figure d’interlocuteur officiel des pouvoirs publics, voire de décideur à la place du décideur. Dans la réalité, sans doute personne, d’autant que les intérêts des exploitants sont à l’évidence divergents. Leur situation économique est extraordinairement contrastée selon les filières et la taille des exploitations, voire à l’intérieur d’une même filière : ainsi, les revenus du premier au dernier décile des éleveurs de porc s’étagent entre 10 000 et 280 000 euros annuels. Quant aux aides de la PAC, elles contribuent au statu quo. Elles ne sont pas seulement inefficaces pour ce qui est de l’objectif affiché de « verdissement ». Tout en représentant un pourcentage essentiel des tout petits revenus agricoles, elles favorisent les grosses exploitations : selon le ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, 20 % des agriculteurs français possèdent 52 % des terres agricoles et touchent 35 % des subventions européennes.
Quel drôle de monde, où les règles démocratiques basiques de représentation sont bafouées, où la transparence électorale semble taboue, où les « gros » qui gagnent très bien leur vie (voire cumulent, comme le patron de la FNSEA, la casquette d’agriculteur et celle de dirigeant d’un grand groupe agro-alimentaire) se cachent derrière les petits et réclament en leur nom une politique publique très coûteuse qui les rendra plus riches encore, tandis qu’une part importante des ménages paysans s’enfonce dans la pauvreté malgré les aides publiques auxquelles ils s’accrochent.
Quid des revendications syndicales ? On voit bien la spécificité de la Confédération paysanne et la cohérence de sa ligne, sans doute minoritaire : c’est le seul syndicat à demander une refonte des aides de la PAC, dans un sens plus redistributif. Mais qu’est-ce qui distingue la FNSEA, héritière des jeunes agriculteurs de la seconde moitié du XXe siècle qui regroupaient les parcelles, séchaient les mares, abattaient les haies, concentraient et mécanisaient l’élevage et créaient de tristes paysages de champs cultivés à perte de vue sur lesquels n’errent que les corbeaux, et la Coordination rurale, qui se présente comme les défenseurs d’une agriculture familiale ? En réalité, ils réclament la même chose, mais sur un ton différent : la Coordination rurale fait du maintien des paysans un enjeu civilisationnel (la terre est un héritage national) et elle joue davantage sur la colère et la violence des « petits », appelant à « dégager » une FNSEA qui n’aurait pas obtenu de résultats suffisants. En définitive, les deux syndicats exigent un soutien massif des pouvoirs publics, au nom de la souveraineté alimentaire et d’une juste rémunération des efforts, veulent une politique protectionniste (les autres pays européens les inquiètent plus que le Mercosur), et, surtout, rejettent toutes les normes environnementales, n’acceptant ni propositions de pratiques alternatives, ni contraintes, ni contrôles. La FNSEA construit un mur pour bloquer l’entrée de l’INRAE, Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, dont les travaux lui déplaisent, et la Coordination rurale réclame, au nom de la « simplification » des normes, la dissolution de l’Office français de la biodiversité qui assure la police de l’environnement (protection de l’eau, des espaces naturels et vérification du respect des règles en ce domaine) : elle menace de brûler les voitures des fonctionnaires qui viendraient contrôler un paysan.
Quelle politique aujourd’hui ?
En janvier dernier, le discours de politique générale de F. Bayrou se situait dans la droite ligne des gouvernements précédents, donnant par principe raison aux agriculteurs, quelles que soient la nocivité de leurs pratiques ou la violence de leurs manifestations. Comme ses prédécesseurs, F. Bayrou agit par intérêt électoral (les Français, attachés à l’image du paysan gardien de la nature et gagnant modestement sa vie grâce à un travail acharné, sont globalement favorables aux agriculteurs), rejet de l’écologie (domaine étranger à la droite) et, aujourd’hui, par désir de durer quelques mois de plus en ne s’aliénant pas l’extrême-droite. Le Premier ministre en a même rajouté en lançant alors une charge contre les contrôles de l’Office français de la biodiversité, dans un contexte où élus et agriculteurs attaquent également l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, en charge du dossier des pesticides), pourtant traditionnellement complaisante envers les intérêts agricoles.
La droite ne se contente pas de déclarations, elle modifie les textes.
Le Sénat a travaillé en ce mois de février 2025 sur le projet de loi pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations, rédigé fin 2023, modifié début 2024 après les manifestations agricoles, laissé sur le carreau lors de la dissolution de l’Assemblée nationale et repris ensuite. Le Sénat a transformé le projet, centré au départ sur la formation des jeunes et la transmission des exploitations. Le texte initial reconnaissait l’agriculture comme revêtant un « caractère d’intérêt général majeur » et affirmait que les diverses politiques publiques devaient concourir à préserver la souveraineté alimentaire, notion de peu de poids dans une Europe ouverte aux échanges. Dans l’espoir de donner de la consistance à ces déclarations d’intention un peu creuses, le Sénat les a complétées, sans grand souci du droit : il serait interdit au pouvoir réglementaire d’aller au-delà des normes européennes ; la reconnaissance de la primauté de la souveraineté alimentaire impliquerait de sécuriser l’approvisionnement en eau des agriculteurs et, dans le domaine des pesticides, de respecter le principe : « pas d’interdiction sans solution efficace » (mais les solutions proposées, jugées contraignants, ne font pas partie des solutions « efficaces ») ; la souveraineté alimentaire obéirait également à une règle de « non-régression », empruntée, ô ironie, au droit de l’environnement ; le texte prévoit en outre d’alléger les sanctions pour les atteintes environnementales, les atteintes « non-intentionnelles » n’étant plus que faiblement réprimées ; certaines atteintes à l’environnement bénéficieraient même d’une « présomption de non-intentionnalité » (nouveau concept juridique qui rappelle la « présomption de légitime défense » que réclament les policiers) et l’arrachage de haies pourrait dans certains cas être qualifié « d’entretien » ; les procédures de recours contre les projets de retenues d’eau ou d’extension des bâtiments d’élevage seraient raccourcies, pour gêner les opposants ; enfin, l’objectif de 2I % des terres cultivées en bio à horizon 2030 disparaîtrait des textes.
Que deviendra le projet de loi à l’issue de la Commission mixte paritaire, voire d’une seconde lecture à l’Assemblée nationale ? Pour l’instant, le gouvernement a validé les votes du Sénat…
Pire, le Sénat a adopté fin janvier 2025 une proposition de loi « visant à lever les contraintes sur l’exercice du métier d’agriculteur ». Le texte réintroduit en France, à titre dérogatoire, un néonicotinoïde jusqu’alors interdit par l’ANSES et permet de rétablir l’autorisation de l’épandage de produits phytosanitaires par drone sur des parcelles difficiles à atteindre. Il met fin à une disposition de la loi EGALIM de 2018 interdisant d’exercer à la fois le rôle de conseil et de distributeur de produits phytosanitaires. Les procédures d’autorisation de la construction et de l’extension des bâtiments agricoles seraient allégées et, en particulier, dispensées de réunions publiques préalables d’information. Quant aux retenues d’eau destinées aux agriculteurs, elles sont présumées « d’intérêt général majeur » pour tenter de les sécuriser, à condition qu’elles répondent à un « stress hydrique ».
On le voit, les digues cèdent. Le gouvernement ne peut répondre, pour des raisons évidentes, à la demande des agriculteurs de « sécurisation de leurs revenus ». Il leur offre alors ce qu’il peut : la levée des contraintes environnementales et l’apposition de l’étiquette « intérêt général » sur des projets critiqués. Les agriculteurs, qui veulent vivre correctement, ne s’en contenteront pas.
A long terme, une telle politique risque d’opposer les agriculteurs et les autres citoyens. Quand les conflits s’ouvriront sur la santé publique, la gestion de l’eau ou la qualité de l’environnement et de l’alimentation, les agriculteurs paieront ce laxisme.
Des agriculteurs prêts à bouger ?
Le laboratoire d’idées The shift project a publié récemment une étude Pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère (novembre 2024) qui propose des solutions pour décarboner l’agriculture, certes avec des contraintes : l’étude prône une transformation des pratiques de fertilisation, une répartition différente sur le territoire de cheptels moins denses, une forte augmentation des cultures de légumineuses, un développement des prairies, le recours à des énergies décarbonées. Au demeurant, avant celle du Shift project, de nombreuses études prospectives (INRAE, CNRS, Terra nova…) ont avancé des recommandations proches.
Toutefois l’étude du Shift project souligne particulièrement deux constats.
Le premier, déjà connu, est la grande vulnérabilité d’un système agricole dont aujourd’hui les rendements baissent, qui est soumis à des contraintes économiques et financières multiformes et à des injonctions contradictoires, dont le poids économique et les forces humaines déclinent, qui va particulièrement souffrir du changement climatique et qui, parallèlement, contribue lui-même fortement à la dégradation du climat, à l’appauvrissement des sols, à la disparition de la biodiversité et au gaspillage des ressources naturelles, ce qui se voit de plus en plus.
Le second constat, tout en soulignant la difficulté des arbitrages et en reconnaissant qu’il est impossible de demander aux agriculteurs seuls de porter le poids des changements nécessaires, porte sur l’aspiration des agriculteurs à trouver des solutions. L’étude du Shift project a été en effet menée de front avec la consultation de 7700 agriculteurs (cf. La grande consultation des agriculteurs, publiée sur le site du Shift project en décembre 2024) : il en ressort que 87 % des agriculteurs se sentent mal représentés dans le débat public ; que 86 % sont inquiets pour l’avenir de leur exploitation, du fait en particulier du changement climatique ; que 75 % sont préoccupés des effets des pesticides sur leur santé ; enfin, que plus de 80 % sont prêts à s’engager dans des pratiques agroéconomiques durables mais à condition (87 %) que le pouvoir politique leur donne une visibilité sur l’accompagnement économique et technique dont ils pourront bénéficier.
Les paysans seraient donc prêts au changement, contrairement à ce que disent leurs syndicats, du moins si un projet cohérent et durable leur est proposé et s’ils sont aidés pour le réaliser. Le gouvernement, au lieu d’encourager les atteintes à l’environnement, est-il prêt à élaborer un projet d’avenir et, surtout, à en supporter le prix ? Ce sera difficile. Il faudrait d’abord que s’effacent les vieux politiciens, tel F. Bayrou qui, dans son discours de politique générale, se lamentait sur le passé : « Les paysans dans le monde dont je viens », disait-il, « avaient la certitude d’être les meilleurs défenseurs de la nature. Aujourd’hui, on les accuse de nuire à la nature et c’est une blessure profonde ». Et si, plutôt que de pleurer sur l’agriculture du siècle passé, on se projetait dans l’avenir ? En politique, la nostalgie est mauvaise conseillère.
Pergama, le 17 février 2025