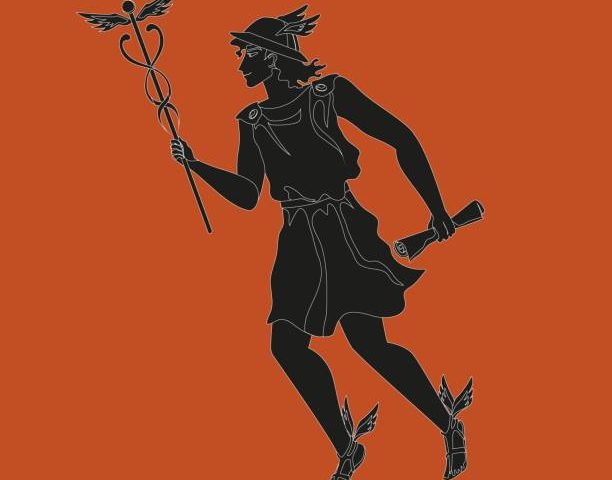Résister à Trump mais pas que

Défense de l’Europe: décider dans l’incertitude, décider sans consensus, décider quand c’est sans doute trop tard, mais décider
17 mars 2025
Justice et politique, préserver le “Check and balance”, régulation et contrepoids
14 avril 2025En instituant d’énormes droits de douane sur les échanges commerciaux avec des pays tiers, le Président Trump a annoncé vouloir réduire l’important déficit commercial des États-Unis qui atteint en 2023, sur les seuls échanges de biens, 1064 Mds de $, dont 280 Mds avec la Chine et 157 Mds avec l’Europe. Pour s’en tenir aux décisions prises à ce jour, sans mentionner les menaces (ainsi des 25 % de droits sur tous les produits européens), 20 % de droits supplémentaires par rapport aux tarifs 2024 frappent désormais les produits importés par les États-Unis en provenance de Chine (la Chine supportait déjà des droits de douane variables selon les produits) ; des droits de 25 % sur les importations américaines en provenance du Mexique et du Canada devraient s’appliquer à compter d’avril (10 % seulement sur l’énergie) ; des droits de 25 % frappent les importations d’acier et d’aluminium aux États-Unis d’où qu’elles viennent et le même taux s’appliquera en avril à toutes les voitures non fabriquées aux États-Unis ; enfin un décret aurait été signé pour que les importations venant des pays qui achètent du pétrole vénézuélien soient taxées à 25 % et la Maison Blanche a annoncé, pour le 2 avril, la mise en œuvre de « droits réciproques », chaque pays se voyant appliquer, pour chaque produit, les droits qu’il applique lui-même pour ses propres achats en provenance des États-Unis.
Si elles sont mises en œuvre, ces décisions auront des conséquences néfastes pour les partenaires commerciaux des États-Unis.
Trump n’est toutefois pas le premier à perturber le jeu du commerce international, même s’il est l’intervenant le plus brutal et, sans doute, le plus borné. Loin de la vision idyllique que les économistes libéraux ont du libre-échange, le désordre est installé depuis un moment en ce domaine, absence de régulation internationale, pratiques déloyales, effets pervers divers. Que faire aujourd’hui dans ce contexte perturbant ?
Les mesures de D. Trump : peu de chances d’atteindre leurs objectifs
Si les droits de douane imposés par D. Trump ont pour objet de rétablir l’équilibre du commerce extérieur des États-Unis, les économistes ont raison de dire qu’il s’agit là d’un remède inapproprié, au moins à court voire moyen terme, car il ne modifie pas les fondamentaux de la production : dès lors que les entreprises américaines ne produisent pas les biens demandés, la conséquence de l’imposition des droits de douane peut certes conduire à une baisse des importations mais celles-ci se poursuivront, avec une relance de l’inflation américaine, mal interne que Trump avait promis de terrasser et qui frappera durement les plus défavorisés. Quant aux entreprises qui devront importer plus cher des matières premières qui leur sont nécessaires, elles répercuteront, si elles le peuvent, l’augmentation de leurs charges sur les prix. S’il n’est de plus pas tenu compte de la complexité des chaînes de production (on cite fréquemment l’exemple de l’éclatement de la fabrication des pièces d’automobile, parfois de part et d’autre d’une frontière, Canada et Mexique), la croissance et l’emploi souffriront. D. Trump a parfois affirmé que ces mesures conduiraient les entreprises étrangères à baisser leurs prix pour garder le marché américain : avec des taux de 20 ou 25 % de droits, la baisse des prix ne suffira pas.
Les économistes ont par ailleurs raison de souligner que le déficit commercial ne se mesure pas qu’avec la balance des biens : or, si l’on y intègre les échanges de services (dont le solde est excédentaire), la balance commerciale totale des États-Unis est moins déficitaire que la balance des biens (773 Mds en 2023). Avec les services, le déficit commercial de l’Union avec les États-Unis n’est plus de 157 mais de 48 Mds. Toutefois, c’est la désindustrialisation du pays (et la pauvreté des États qui en sont victimes) qui préoccupe le Président Trump, désindustrialisation qui a, d’ailleurs, également préoccupé son prédécesseur. L’objectif principal est d’augmenter la production américaine en facilitant l’implantation de nouvelles entreprises par des baisses d’impôts et l’assouplissement des réglementations. Les droits de douane imposés en sont une conséquence, un outil de persuasion pour que les entreprises s’implantent et un outil de protection ensuite de leur production.
Les États-Unis ont certes engrangé un certain nombre de promesses d’entrepreneurs en ce sens. Pour autant, la réindustrialisation est un processus qui prend du temps, l’industrie procure moins d’emplois qu’autrefois, elle requiert souvent des compétences et les entreprises peuvent être dissuadées de venir par l’instabilité des décisions du Président.
Enfin, Donald Trump a annoncé pendant sa campagne vouloir remplacer l’impôt sur le revenu par le montant des droits de douane : l’espoir est fallacieux. Dans une note de novembre 2024, Le prix du protectionnisme de D. Trump, le CEPII (Centre d’études prospectives et d’informations internationales) a calculé l’impact d’une institution généralisée de droits à 10 % (gain : 300 Mds), à 20 % (gain : 480 Mds), à 80 % (gain : 820 Mds), à comparer avec le montant de l’impôt sur le revenu, 2600 Mds en 2023. Les droits peuvent aider à baisser les impositions des entreprises mais ne compenseront pas une diminution d’envergure des impôts.
Mesurer les conséquences ?
Il est trop tôt pour mesurer de manière précise les effets de l’augmentation des droits de douane (la durée en est incertaine, les mesures de rétorsion ne sont pas connues) mais quelques analyses donnent un aperçu des conséquences.
Le bilan des hausses qui ont eu lieu pendant le premier mandat de Trump est intéressant, même si elles étaient bien plus limitées et visaient, pour l’essentiel, la Chine. Les importations chinoises ont alors baissé, mais moins qu’espéré, d’une part à cause de pratiques de contournement (le Vietnam et le Mexique, dont les importations chinoises ont augmenté tout comme leurs exportations vers les États-Unis, ont joué le rôle d’états intermédiaires), d’autre part à cause de l’exemption des envois de faible valeur qui se sont alors beaucoup développés. Surtout, selon une revue de littérature citée par la revue Le Grand Continent (Changer la mondialisation par les tarifs, mars 2025), les études économiques sont unanimes à reconnaître que les consommateurs américains ont entièrement supporté l’augmentation des droits quand elle a eu lieu.
Les prévisions de l’OCDE (17 mars 2025) reposent quant à elles sur un scénario plus proche des décisions qui s’esquissent aujourd’hui, soit une augmentation générale de 25 % des droits de douane américains. La croissance mondiale en serait affectée, avec une baisse de 0,2 et de 0,3 points par rapport aux prévisions antérieures, dès 2025, plus nettement en 2026. Les pays seraient inégalement touchés, le Mexique et le Canada l’étant particulièrement (le cabinet Oxford Ecomomics prévoit une récession dans ce pays en 2026), l’Europe l’étant moins (en tout cas au niveau global) et la Chine compensant les difficultés de ses entreprises par des aides gouvernementales accrues. Les États-Unis connaîtraient une baisse de leur PIB de -0,2 point en 2025 et – 0,4 point en 2026 par rapport aux prévisions, soit seulement 2,2 points de croissance en 2025 contre 2,8 en 2024 et moins encore (1,6) en 2026. La situation conduirait à une baisse des investissements et à une relance de l’inflation, notamment aux États-Unis. Selon l’OCDE, des mesures de rétorsion aggraveraient fortement ces prévisions, en particulier pour les ménages américains. La Chine en a déjà prises mais pour l’instant de manière plutôt modérée, le Canada annonce avoir l’intention d’en prendre et l’Europe négocie mais se résignera sans doute à riposter.
Malgré les incertitudes, il est clair que les mesures du gouvernement américain seront dommageables pour tous.
Incohérence, escalade, asservissement des partenaires, folie dominatrice ?
Les décisions sur la réduction du déficit commercial américain font partie d’un ensemble qui comporte également des engagements de baisses d’impôts, des baisses drastiques de dépenses publiques et l’expulsion de centaines de milliers de travailleurs étrangers. Le risque est d’augmenter une dette publique déjà énorme et qui croit chaque année de 2000 Mds, de provoquer des désordres dans le marché de l’emploi qui pénaliseront les entreprises, de freiner les investissements et de relancer l’inflation. Le monde économique goûte peu l’incertitude et le jeu auquel se livre Trump, avec annonces, contre-annonces, déclaration subite, délai accordé puis repris, génère une anxiété peu favorable à la croissance.
Si la récession touchait les États-Unis (ce que les économistes ne prévoient pas aujourd’hui), la crise pourrait s’étendre : les multinationales françaises ou européennes réalisent une part importante de leur activité dans le pays.
Enfin, certaines analyses ont évoqué récemment un projet plus tortueux des États-Unis porté par S. Miran, président du Conseil économique de D. Trump : selon celui-ci, le déficit commercial des États-Unis est lié à la surévaluation du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Miran propose que les partenaires commerciaux des États-Unis, parce qu’ils tirent un bénéfice de la situation du dollar, payent une partie du coût qui en découle, soit en payant des droits de douane, soit en s’engageant à acheter davantage de biens américains, soit en acceptant d’acheter des bons du Trésor de dette américaine dans des conditions moins avantageuses qu’aujourd’hui, avec une taxe et sur le très long terme (le projet serait un engagement de 100 ans). Cette dernière solution aurait selon Miran pour avantage, dans un contexte où les projets de D. Trump augmenteraient la dette (celle-ci pourrait passer de 121 à 140 % du PIB selon certaines évaluations), d’en atténuer les conséquences.
Mais comment le monde pourrait-il accepter cet asservissement généralisé à une puissance qui n’aurait plus en vue que son propre intérêt ? Comment la confiance, qui est la pierre angulaire des investissements financiers, pourrait-elle se maintenir ? Hérodote avait sans doute raison quand il affirmait que le ciel rabaisse toujours celui qui dépasse la mesure, et sanctionne l’ubris de ceux qui se laissent enivrer par leur orgueil.
Dès avant Trump, un commerce international perturbé.
Longtemps les diverses écoles d’économistes se sont accordées sur les bienfaits d’un commerce international le plus proche possible du libre-échange, avec spécialisation des pays, meilleure allocation des ressources, économies d’échelle, baisse des prix, variété des produits offerts aux consommateurs. De fait, son développement, dans la seconde moitié du XXe siècle, a eu indéniablement le grand mérite d’inclure des pays nouveaux, de réduire la pauvreté au niveau mondial et de développer la consommation en en réduisant le coût. L’Union européenne, elle-même créée en tant que zone de libre-échange, a augmenté sa richesse d’ensemble. Cette conception explique que les droits de douane, qui perdurent dans le monde, soient alors, dans certaines zones, devenus résiduels : ainsi entre l’Union et les USA, avant Trump II, les importations américaines en provenance de l’Union supportaient en 2023 des droits de 1,4% en moyenne et les importations de l’Union en provenance des États-Unis étaient taxées à environ 1 %.
Toutefois, dès les années 2010 et encore davantage dans les années récentes, la vision du commerce extérieur a changé. En premier lieu, les règles internationales qui auraient dû permettre de garantir la loyauté des échanges ne sont pas ou plus appliquées. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui a succédé au GATT et devait imposer le principe de non-discrimination, l’interdiction du dumping et la limitation des droits de douane à certaines situations, n’a jamais bien fonctionné. Dans cet échec, les dissensions entre les pays du Sud et les pays développés ont joué, tout comme le refus de certains d’accepter des normes universelles et une procédure de règlement des différends : accusant l’OMC de partialité, les États-Unis (avant Trump, sous la présidence Obama) ont bloqué le dispositif. Depuis lors, l’OMC s’est affaiblie. Au demeurant, peu de commentateurs ont souligné que l’institution récente des droits de douane sur les importations américaines était non seulement inique, économiquement déraisonnable, mais aussi illégale : l’OMC ne compte plus.
Surtout, depuis longtemps, la Chine est soupçonnée de ne pas être une économie de marché, de subventionner massivement sa production, d’avoir organisé méthodiquement des transferts de technologie ou d’y avoir procédé frauduleusement, faussant ainsi la concurrence à son bénéfice. La disparition du photovoltaïque européen après l’effondrement des prix lié à une surproduction mondiale (dont la Chine s’est bien tirée grâce à un dumping forcené) a laissé des traces. Aujourd’hui, c’est la production chinoise de voitures électriques à bon marché qui fait craindre aux producteurs européens une concurrence déloyale. Même si elle connaît aujourd’hui un affaiblissement, la Chine fait peur : elle domine le commerce international de manière écrasante, elle peut miner les industries européennes fortes, comme celle de l’Allemagne, elle s’implante dans tous les secteurs d’avenir. L’on comprend alors les premières mesures prises par l’Union : après une enquête « antisubventions », des droits compensateurs pouvant aller jusqu’à 35 % ont été mis en œuvre en 2024 sur les importations de véhicules chinois électriques à batterie.
Quant aux États-Unis, cela fait longtemps qu’ils mènent une politique de préférence nationale dans le domaine commercial : Joe Biden a maintenu une grande part des droits de douane décidés par son prédécesseur à l’égard de la Chine, renforcé le Buy American Act de 1933, promulgué le Chips Act et l’Inflation Reduction Act pour subventionner massivement l’industrie des microprocesseurs et les technologies vertes.
Quant au débat sur la contradiction entre la politique de protection de l’environnement et l’importation de productions qui le saccagent, il ne fait que commencer : il sera difficile à régler comme le montrent les interrogations sur l’effectivité des « clause-miroirs » dans les traités de libre échange ou les interrogations sur les conséquences de l’institution de la taxe carbone aux frontières européennes.
Des déficits commerciaux considérés désormais comme néfastes ou imprudents
La pétition de principe en faveur des bienfaits du commerce international a conduit nombre d’économistes à relativiser l’importance des déficits et des excédents commerciaux des pays. Selon eux, tout le monde gagnerait au processus d’échanges hors cas d’espèces : un pays en croissance peut être commercialement déficitaire et financer ce déficit très sainement en acceptant des investissements étrangers ; un pays peu dynamique peut être commercialement excédentaire s’il exporte ses ressources énergétiques à bon prix sans investir. Au final, le déficit ou l’excédent commercial ne voudrait rien dire en soi et des ajustements dans les politiques monétaires ou économiques pourrait toujours aider à pallier les risques.
Cette vision distanciée a cessé. Un déficit commercial prononcé et durable est désormais vu pour ce qu’il est : la traduction d’une moindre productivité et un risque de dépendance pour des biens stratégiques. L’Europe a pris largement conscience de sa dépendance sur un certain nombre de biens, qu’elle a listés. Les États-Unis sont, eux aussi vulnérables : le CEPII souligne (in Dépendances commerciales, février 2025) que leurs importations comportent une forte proportion de produits « dépendants » (la dépendance d’un produit tient compte de la forte concentration des achats et de la difficulté de substituer un fournisseur à un autre), qui sont parfois aussi des produits stratégiques. La Chine est le principal exportateur des produits pour lesquels les États-Unis sont dépendants (50 %). Certes, l’Union européenne est dans une situation pire (60 % de dépendance face à la Chine) mais elle a aussi des armes que n’ont pas les États-Unis car elle fournit à la Chine 25 % des produits dont ce pays est lui-même dépendant. En tout état de cause, l’exemple révèle l’ampleur des conséquences d’une guerre commerciale généralisée et d’une l’escalade mal maîtrisée mais il doit aussi inciter à se réarmer dans la production de certains biens.
Au final, que doit faire l’Europe ?
A court terme, l’Europe doit à la fois négocier avec les États-Unis et les menacer de représailles fortes, en en acceptant les risques. Elle s’est dotée d’un arsenal de textes, du règlement d’application de 2014 modifié en 2021 qui permet de lutter contre les droits de douane abusifs, y compris en introduisant des restrictions au commerce de services, au règlement contre les subventions étrangères ou à l’instrument anti-coercition, qui lui donne des moyens de réagir contre les politiques de chantage. L’inquiétude porte néanmoins sur la lenteur des procédures à mettre en œuvre et surtout sur les divisions internes : les pays européens sont inégalement touchés par les mesures de D. Trump et il n’existe pas de consensus complet sur l’opposition à la guerre idéologique qu’il mène. Déjà une note du Conseil d’analyse économique de 2018 (Avis de tempête sur le commerce extérieur, quelle stratégie pour l’Europe ?) recommandait prioritairement une rétorsion ferme et crédible ainsi que le développement d’accords commerciaux avec des partenaires aptes à jouer le rôle de pare-feu en cas de guerre commerciale. L’Europe saura-t-elle le faire ?
A plus long terme, l’Europe doit se protéger par des droits de douane contre une Chine dont la puissance industrielle est écrasante (40 % de son PIB, 18 % des exportations mondiales), qui a beaucoup investi dans les industries les plus innovantes et qui pratique le dumping de manière systématique avant de remonter ses prix. L’Union le doit d’autant plus que les mesures prises par les États-Unis contraindront la Chine à réorienter vers l’Europe son agressivité commerciale. Mais l’Europe, pour se protéger, doit parallèlement réduire sa dépendance. Jusqu’alors, les mesures de réindustrialisation et, en particulier, le Chips Act européen de 2023, qui entendait développer sur le sol européen la production des semi-conducteurs, est un échec reconnu. Reste à trouver les ressources nécessaires et chacun repense au rapport Draghi…L’Europe doit donc choisir d’être plus forte et plus autonome, non seulement dans le domaine de la Défense mais en élaborant également une politique commerciale plus stricte et une politique industrielle plus efficace. En aura-t-elle l’énergie ?
Pergama, le 31 mars 2025