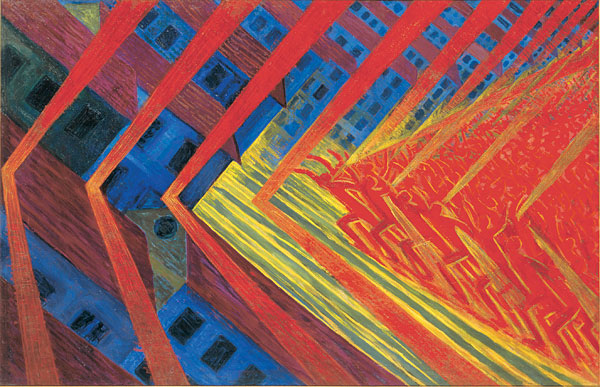Le macronisme est mort, quelle leçon en tirer?

La France n’est pas seule à être en crise : l’Europe, affaiblie et humiliée, l’est aussi
13 octobre 2025
Protection sociale: ne plus gérer à la petite semaine
10 novembre 2025Avec le ratage des divers avatars du pouvoir qui se sont succédés depuis la dissolution de 2024, le pays est à un tournant de son histoire politique. Parce que la population est dévorée par le ressentiment envers sa classe politique, il est à craindre qu’elle le négocie mal et plonge dans le choix irraisonné d’une extrême droite incapable de diriger le pays. Les causes du mal sont très anciennes : mieux les comprendre permettra peut-être d’éviter une catastrophe annoncée.
La méfiance envers les politiques et les élites vient de loin
Dans une conférence organisée par Sciences-po en septembre 2024, Victoires sans gagnants et défaites sans vaincus, le politologue de l’IPSOS Matthieu Gallard a présenté les résultats aux législatives depuis 1978 sous un nouvel angle, en utilisant le rapport entre les votes en faveur du gouvernement et ceux de l’opposition, le tout par rapport aux inscrits. En 1978, pour 1 votant qui soutenait le gouvernement, 1,1 avait choisi l’opposition, les autres ayant fait le choix de s’abstenir ou de voter blanc (2,6 inscrits en tout). En 2017, on décomptait, sur 5,4 inscrits, pour 1 votant favorable à la « majorité », 2,1 opposants et, en 2022, avec une très forte abstention, pour 1 électeur « majoritaire », 2,9 opposants, sur 7,3 inscrits. En 2024, l’abstention a diminué mais la relation entre majoritaires et opposants s’est à peine redressée : pour 1 vote majoritaire, 2,3 votes d’opposants, le tout sur un total de 4,1 inscrits. Le calcul démontre que la « majorité » a toujours été minoritaire dans le pays et que l’écart s’est amplifié : le scrutin majoritaire a permis de dissimuler cette réalité.
On connaît par ailleurs les données de l’enquête Fractures françaises sur le fonctionnement de la démocratie et l’image des hommes politiques. L’on était déjà suffoqué de constater, au début des années 2010, l’appréciation négative du système politique (72 % de personnes jugeant qu’il fonctionne mal) et des dirigeants (corrompus à 62 %, principalement motivés par leur intérêt personnel à 82 %). 2025 marque encore une dégradation : aujourd’hui, 81 % des Français se sentent mal représentés et jugent que le système démocratique fonctionne mal. Le sentiment d’une corruption généralisée est à un haut niveau (66 %) et 87 % des Français sont d’avis que les élus pensent d’abord à leur intérêt personnel. Selon l’enquête IPSOS État de la démocratie en 2024, qui compare 8 pays occidentaux, la France est le pays le plus mécontent du fonctionnement de son système politique. Elle figure parmi ceux qui considèrent à une forte majorité (en l’occurrence 68 %) que les dirigeants privilégient les riches et les puissants et se soucient peu des autres, et c’est ce constat d’une partialité sociale qui la conduit à souhaiter, à 56 %, un changement politique radical.
Comment expliquer cette colère, qui s’intensifie certes avec la crise traversée aujourd’hui, mais qui est en même temps ancienne ? Les Présidents Sarkozy et Hollande sont en partie responsables. Emmanuel Macron l’est davantage : plus encore que ses prédécesseurs, il a promis la lune sans jamais avoir l’intention d’aller la chercher. Pire, il a privilégié ses propres obsessions sur les demandes sociales.
Anciens quinquennats : engagements non tenus, idéologies qui tournent à vide, questions essentielles non résolues
Opportunistes, les dirigeants ne tiennent guère leurs engagements. De Nicolas Sarkozy, l’on se souvient du revirement brutal sur la politique environnementale, alors qu’il s’y était beaucoup engagé, reniée dès lors qu’il en a compris les contraintes. Mais qui se souvient de ses reniements sur la politique de santé (qui devait être libérée du « rationnement » alors que celui-ci a été renforcé), de la réforme de la dépendance retardée 10 fois avant d’être abandonnée, des promesses sans suite faites aux quartiers sensibles ou aux enseignants ?
Toutefois, ce ne sont pas les promesses oubliées qui choquent le plus, ce sont les faibles résultats des politiques menées et, surtout, la négligence de besoins sociaux essentiels.
Nicolas Sarkozy a porté plusieurs ambitions : d’abord la relance économique par des baisses d’impôt et de charges, politique qui s’est avérée dès l’origine peu concluante, puis contreproductive avec la survenue de la crise économique ; ensuite, le durcissement des sanctions pénales, qui n’a eu aucun effet sur le niveau de la délinquance ; puis l’assurance que les emplois de fonctionnaires pouvaient être drastiquement diminués tout en produisant d’importantes économies, ce qui a mis à mal les services publics sans rapporter beaucoup ; enfin, l’immigration « choisie », où la moitié des entrées devait relever d’une immigration sélectionnée : mais les flux d’entrée n’ont pas été fondamentalement modifiés. Tout s’est passé comme si les discours patinaient dans le vide. Le seul résultat obtenu a été d’ancrer dans l’opinion des thèmes clivants alimentant la colère : la mondialisation augmente le chômage et fragilise l’économie, l’immigration est porteuse de délinquance et coûte cher, les fonctionnaires sont trop nombreux et la justice laxiste. Le quinquennat ne s’est au final guère attaché à résoudre les véritables difficultés du pays, retard économique, impérieuse nécessité d’améliorer l’éducation et les services publics, montée des difficultés agricoles, chômage de la jeunesse, atteintes à l’environnement. C’est pendant ce quinquennat que la justice a commencé à perdre pied, que les déserts médicaux se sont aggravés, que le chômage a connu une aggravation durable.
François Hollande a lui aussi oublié très rapidement des promesses essentielles de sa campagne, que ce soit la lutte contre les contrôles au faciès, la loi sur l’assistance médicale à mourir, la refonte de la fiscalité locale ou la clarification des compétences entre collectivités. Malgré des efforts indéniables, la refondation promise sur l’éducation n’a pas eu lieu.
Son vrai bilan est ailleurs : il s’est inscrit, de manière très étonnante, à contre-courant de ses promesses. L’aide aux entreprises ne figurait pas dans son programme : pourtant, pour améliorer leur compétitivité, il a consacré énormément d’énergie et d’argent à mettre en place un système d’allégement des charges sociales dont l’avenir montrera la faible efficacité, liée en partie à l’absence de ciblage. La France « socialiste » a été par ailleurs peu solidaire de l’Europe dans l’accueil des migrants en 2015 (elle ne remplira pas ses modestes engagements de « relocalisation » des réfugiés arrivés dans les pays du sud de l’Europe). Enfin, en 2015, le président, attaché sans doute aux libertés essentielles, a mis en œuvre une politique anti-terroriste dont il ne parviendra pas à contrôler les excès. Pour satisfaire une opinion publique persuadée que les atteintes aux libertés renforcent la protection, il sera incapable de sortir, au bout de presque 2 ans, d’un état d’urgence liberticide devenu inutile depuis longtemps. La gauche modérée ne s’est jamais remise de ce quinquennat parfois assimilé à une forfaiture. La population dans son ensemble a surtout retenu la hausse des impôts sur les ménages, le caractère tardif du redressement d’après-crise ainsi que l’amorce d’une politique climatique, à vrai dire surtout en affichage.
Ces deux quinquennats ont été troublés, pesants, clivants. La situation internationale a certes pénalisé le pays mais les défis économiques et sociaux n’ont pas été vraiment pris à bras le corps. La cohésion nationale a été altérée : montée de la xénophobie, assimilation de la solidarité à l’assistanat et mise en accusation des fonctionnaires.
La force d’Emmanuel Macron a été, en 2017, de prôner la rupture, en suscitant un espoir réel de renouveau et la déception ensuite ressentie n’en a été que plus forte.
Le macronisme : forte séduction, désillusion rapide et mort lente.
Le message essentiel du macronisme en 2017 était que la France, si elle surmontait ses blocages, serait en mesure d’affronter les changements qui lui faisaient peur, la mondialisation, le numérique, la question climatique et les conflits géopolitiques. Dans un pays méfiant envers l’Union européenne (moins de la moitié des Français voient en 2016 l’appartenance à l’Union comme une bonne chose) et qui regardait la mondialisation comme une menace (à 58 % en 2016), ce positionnement lui a, paradoxalement, été bénéfique. L’enquête de juin 2017 Ipsos Sopra Stéria sur Les fractures françaises montre combien le discours volontariste d’Emmanuel Macron « a pris » (certes provisoirement), avec un regain de confiance envers les institutions, une moindre adhésion à l’idée de déclin du pays et une meilleure confiance dans l’ouverture au monde.
Le second facteur de succès a été la volonté de dépassement du clivage droite/gauche, ce qui a permis au macronisme de réunir une droite désireuse de réussite économique mais pas réactionnaire et une gauche modérée excédée par le quinquennat Hollande. Cette dernière a été séduite par des signes d’ouverture, la proposition d’un « pacte girondin » avec les collectivités, la promesse d’une démocratie plus participative ou la référence à une Angela Merkel qui aurait « sauvé la dignité de l’Europe » en accueillant les demandeurs d’asile de 2015, toutes annonces manipulatrices et illusoires.
Quand le macronisme est-il mort ?
Dans son commentaire de Fractures françaises 2025, le politiste Luc Rouban situe le décès soit à l’automne 2024, quand la situation s’est délitée après la dissolution, soit lors de la récente suspension de la réforme des retraites, qui témoigne de l’abandon de la volonté d’origine : faire prévaloir la « modernisation » du pays sur les demandes sociales, quoi qu’il en coûte. En réalité, le macronisme est sans doute mort dès 2018, même si son électorat n’a évolué que progressivement vers la droite. Dès cette date, la loi immigration a durci le droit et les populations modestes et fragiles ont été frappées (augmentation de la taxe carbone en 2018, réforme de l’assurance chômage en 2019) tandis que l’institution de la flat-tax enrichissait les riches et les très riches. Caractérisé par un style (un souverain qui installe une verticalité méprisante et qui ne supporte pas les contre-pouvoirs), par une pensée ultra-libérale qui s’apparente au saint-simonisme du XIXe siècle (l’État s’identifie aux intérêts des producteurs dans une société dont les clivages sociaux sont invisibilisés), le macronisme s’est dévalorisé par son élitisme, sa pratique de l’autorité, sa politique pro-riches. Il s’est décrédibilisé aussi par son indifférence envers l’avenir : dédain pour l’écologie, statu quo mortifère du modèle agricole, refus de voir que l’Éducation nationale avait d’autres besoins que le dédoublement des petites classes, mise en danger des finances publiques en poursuivant les baisses d’impôt des entreprises même pendant la crise COVID. Son refus obstiné de négocier la réforme des retraites, qui pénalisait surtout les travailleurs modestes et les seniors au chômage, l’a perdu. Comme ses prédécesseurs, il n’a pas répondu aux attentes.
L’avenir : résister au RN ?
L’enquête Fractures françaises dessine l’avenir : montée des colères et du mécontentement, surtout chez les jeunes et les classes populaire, pour l’essentiel sur les questions économiques et sociales, rage de voir monter les inégalités et de supporter les difficultés à joindre les deux bouts quand les riches continuent à bénéficier de privilèges exorbitants et quand les « assistés » sont soupçonnés de profiter du système. La préférence pour le Rassemblement national devient forte : 47 % des Français le jugent apte à gouverner, même si 49 % le jugent dangereux. Les classes populaires et moyennes vont chercher dans ce parti les solutions qu’ils n’ont pas trouvées ailleurs, sans pour autant voir que son programme n’est pas cohérent et pas crédible.
Que faire, si du moins il n’est pas trop tard ? La crise est si profonde qu’après avoir tablé sur des changements institutionnels (à court terme, choix de la proportionnelle et dissolution, à plus long terme, retour à un partage plus équilibré des responsabilités entre le Président et le Parlement), les politistes reconnaissent aujourd’hui que ces remèdes ne suffiront pas. Il en est probablement de même de l’institution maintes fois souhaitée et très souhaitable de mécanismes de démocratie participative; c’est un peu tard pour compter pleinement sur ces réformes.
La demande aujourd’hui porte sur un changement des mentalités politiques : les responsables publics aujourd’hui ne sont plus à l’écoute de la société. Ils ont perdu la capacité de réformer et de gérer les dissensions. Ils avancent dans leur couloir (c’est le cas des macronistes et des Républicains et, de manière différente mais tout aussi fermée, c’est aussi le cas de LFI) ou bien, parce que toute entreprise réformatrice est risquée, se contentent de mesures superficielles qui donnent l’apparence d’une solution sans en être une (c’est plutôt le penchant des socialistes et de certains centristes). C’est pourtant l’essence même du métier politique que de se saisir de questions complexes et clivantes (les aides aux entreprises, la mixité sociale, l’éducation dans les zones défavorisées, l’insertion des migrants, la transformation de l’agriculture, la lutte contre le dérèglement climatique) et de parvenir à débloquer le pays, en s’appuyant le plus possible sur le dialogue et en abandonnant des positions idéologiques factices.
La politique doit aussi répondre à des exigences émotionnelles : chez certains, la colère et le ressentiment viennent du mépris des élites, du sentiment de ne pas être respecté, de ne pas compter. Chez d’autres (les jeunes), c’est la peur de l’avenir qui domine : ils anticipent la brutalité du changement climatique, l’instabilité d’un monde où la vérité et le droit sont pervertis et où la justice sociale recule. Il est important de parler de ces insatisfactions et de ces craintes.
La France dispose-t-elle du personnel politique capable de répondre à ces besoins ?
Pergama, le 27 octobre 2025