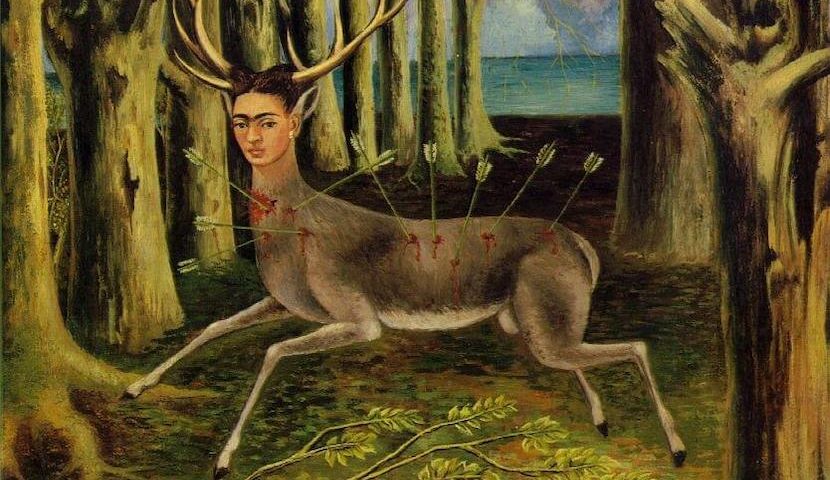Protection sociale: ne plus gérer à la petite semaine

Le macronisme est mort, quelle leçon en tirer?
27 octobre 2025
Élection du maire de new-York : quelles leçons pour la France?
24 novembre 2025Cette première semaine de novembre, l’Assemblée nationale a examiné le PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, corrigé par la lettre rectificative du 23 octobre du Premier ministre qui acte notamment de la suspension de la réforme des retraites.
En présentant son projet, l’objectif du gouvernement était, dans le prolongement du projet Bayrou, de rectifier à toutes forces la trajectoire inquiétante des finances sociales : il est vrai que le déficit des régimes de base de la sécurité sociale, toutes branches confondues, qui atteignait 15,3 Mds en 2024, s’est fortement aggravé en 2025, passant à 23 Mds. Le déficit 2024 était lui-même en nette augmentation par rapport à celui de 2023 (10,8 Mds) : la Cour des comptes souligne ainsi (La situation financière de la sécurité sociale, novembre 2025) que, en deux ans, le déficit a plus que doublé, passant de 10,8 à 23 Mds, à cause du risque maladie (solde négatif de 17,2 Mds) et, plus modérément, de celui du risque vieillesse (5,8 Mds). Cette évolution, dans une année morose mais sans crise économique majeure, est liée à une nette augmentation en volume des prestations servies. Alors qu’elle semblait s’être remise du COVID, la dégringolade financière de la sécurité sociale paraît hors de contrôle, avec, en maladie, un dérapage des arrêts de travail et une augmentation des prescriptions.
Dans ces conditions, l’on peut comprendre que l’approche des pouvoirs publics soit d’abord financière, avec la volonté de freiner cette chute : tendanciellement, si rien n’est fait, le déficit passerait à 28 à 29 Mds en 2026, accroissant le poids de la dette sociale. Le PLFSS soumis aux parlementaires prévoyait ainsi de réduire à 17,5 Mds le déficit 2026.
Toutefois, il est moins compréhensible que les réponses proposées ne soient qu’une liste de recettes nouvelles et d’économies socialement discutables ou peu réalistes, comme s’il fallait à toutes forces afficher un redressement, sans interrogation sur la durabilité du rééquilibre ou l’équité des mesures. Dans la semaine qui vient de s’écouler, les députés ont donc revu en profondeur la partie recettes de ce projet, en adoptant un texte très différent de celui qui était initialement proposé. Ils vont examiner la semaine qui vient la partie dépenses, avec un risque non négligeable de censure du gouvernement.
La vérité est que la politique suivie n’a pas de sens : un jour ou l’autre, il faudra apporter des réponses structurelles au déficit et ne pas se contenter de passer l’année en cours, comme le gouvernement le fait depuis des lustres.
LFSS 2026 : un schéma gouvernemental qui ne tiendra pas
Le schéma de financement du PLFSS 2026 présenté aux parlementaires était assez peu modifié par rapport à celui de 2025 : les 660 Mds de recettes résultaient d’une prévision de croissance 2026 de 1 % (dont on peut considérer qu’elle est optimiste) et de 2,1 Mds de financements supplémentaires. Pour autant, ces recettes nouvelles comportaient de multiples « irritants », comme la fin des exonérations de cotisations sociales qui profitaient jusqu’ici à des compléments de salaire comme les titres-restaurant (mesure rejetée par l’Assemblée nationale), la taxation des organismes complémentaires d’assurance maladie (rejetée par l’Assemblée nationale) ou le gel du barème CSG sur les revenus de remplacement, mesure remplacée lors du vote de l’Assemblée par une hausse de la CSG sur les revenus du capital. Côté recettes, l’Assemblée a tout réécrit.
Quant aux économies prévues dans le PLFSS 2026 (9 Mds), dont l’Assemblée va commencer l’examen dans la semaine du 10 octobre, l’essentiel tient à deux mesures, le gel des prestations sociales et une faible progression de l’ONDAM (objectif national des dépenses maladie), grâce à une flopée de mesures d’économies : baisse des prix des produits de santé, « meilleure efficience » des dépenses hospitalières, doublement des franchises médicales (contribution des malades sur l’achat de médicaments, les transports et les actes paramédicaux), augmentation du ticket modérateur à l’hôpital et baisse des indemnités journalières…
Le coût de la suspension de la réforme des retraites (qui vient en déduction du total des économies) est, dans ce cadre, présenté comme quasi-nul, sachant cependant qu’il est calculé de manière très optimiste, en tenant compte de la sous-indexation des pensions (qui ne sera sans doute pas maintenue) et en y intégrant certaines recettes affectées, qui seront très probablement annulées elles aussi.
Pas plus que le volet recettes, ce volet économies ne tiendra. Le Premier ministre a lui-même reconnu, dès avant la discussion en séance, que le gel des prestations sociales n’était pas accepté par l’opinion publique. Il est, de fait, inacceptable, puisqu’il frappera particulièrement les plus modestes, voire les plus pauvres. Quant à la progression de l’ONDAM, fixée pour 2026 à + 1,6 %, il ne faut pas se raconter d’histoires. Le tendanciel d’évolution spontanée de l’ONDAM 2026 est, selon la Cour des comptes, de + 3,4 %. Le Parlement peut toujours voter une progression très inférieure : le risque est que les dépenses dérapent en cours d’année, nécessitant, comme cela a été le cas en 2025, un nouveau plan d’économies encore plus dur. Surtout, le comité d’alerte de l’ONDAM, en charge de suivre son évolution en cours d’année, a signalé à plusieurs reprises qu’une contrainte trop volontariste sur les crédits d’assurance maladie (et, en particulier, le gel des crédits destinés aux hôpitaux) se traduisait par une augmentation du déficit des hôpitaux publics : de fait, la DREES note, dans une publication récente (La dégradation des comptes financiers des hôpitaux publics se poursuit en 2024, juillet 2025) que le déficit des établissements publics de santé atteint près de 2,9 Mds en 2024, avec, comme conséquence, une baisse de leurs investissements. Comme ce déficit se reproduit d’année en année, la dette globale des établissements de santé publics atteint désormais 30 Mds. Cela explique que le Premier ministre ait, depuis peu, décidé d’ajouter 1 Mds à la dotation destinée aux hôpitaux. Voter une très faible évolution de l’ONDAM, c’est donc se voiler la face.
Comme pour le budget de l’État, le débat sur les recettes et les dépenses sociales pose de manière crue une question fondamentale : est-ce aux malades, retraités et chômeurs les plus modestes de supporter l’impact du déficit? Dès lors que les partis s’affrontent sur cette question, la discussion devient confuse. La ministre des comptes publics a indiqué qu’elle ne voulait pas que le déficit 2026 dépasse 20 Mds. Mais sans gel des prestations et avec un relèvement de l’ONDAM, on n’y arrivera pas.
Au-delà, se pose une question bien plus grave : si l’on parvient à régler le cas de 2026, quel sera l’avenir du système de protection contre les risques sociaux ?
L’avenir : une question sans réponse
Le PLFSS 2026 s’accompagne de prévisions pour les années suivante, pour 2027, 2028 et 2029. Ces prévisions, qui intègrent les recettes nouvelles et les économies prévues dans le PLFSS 2026 d’origine, montrent que le déficit prévu en 2026 (-17,5 Mds) se maintiendrait les années suivantes. Autrement dit, même si l’effort important proposé en 2026 était accepté, cela ne résoudrait rien : la question de l’équilibre financier du système de sécurité sociale resterait entière les années suivantes.
Ce constat renvoie à deux questions, l’une de court terme, l’autre, plus structurelle.
A court terme, le rapport de la Cour des comptes de novembre 2025 évoque une urgence, celle de la gestion de la dette sociale. Rappelons que celle-ci est en premier lieu assurée par la CADES (Caisse d’amortissement de la dette sociale) qui, avec les ressources fiscales qui lui sont affectées, porte et rembourse la dette sociale que le Parlement a mis à sa charge. Fin 2024, il restait à la CADES 138 Mds à amortir, ce qu’elle devrait faire d’ici 2033, la dernière décision de transfert ayant été prise en 2020. A l’époque, l’espoir était que les déficits disparaitraient les années suivantes. Cela n’a bien évidemment pas été le cas : c’est depuis lors l’ACOSS (agence de financement des organismes de sécurité sociale qui centralise les recettes du système) qui porte, sur sa trésorerie, les déficits. Or, leur accumulation rend la situation intenable : fin 2025, l’ACOSS devra « porter » plus de 60 Mds de dette et, fin 2029, si rien n’est fait, 135 Mds. Cette charge obérera peu à peu les capacités de prise en charge des prestations sociales. La CADES quant à elle n’a pas les ressources nécessaires pour prendre en charge la dette qui pèse aujourd’hui sur l’ACOSS.
Il est donc impératif d’attribuer à la CADES de nouvelles ressources fiscales pour qu’elle puisse reprendre, une nouvelle fois, la dette accumulée. Politiquement, chacun convient désormais que, pour accepter cette perspective, l’élaboration d’un plan crédible de retour à l’équilibre du système social est nécessaire. Il faut donc trouver de l’argent pour la CADES et élaborer une stratégie de retour à l’équilibre dans des conditions socialement acceptables.
En tout état de cause, il faut ouvrir les yeux sur la nature du déficit social. Le risque maladie en représente les ¾, le déficit du risque vieillesse étant plus réduit (¼) et la branche famille étant à l’équilibre. Le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie rappelait récemment (in Pour un redressement durable de la sécurité sociale, 3 juillet 2025) que les recettes du système évoluaient comme le PIB mais que les dépenses maladie obéissaient à une dynamique différente, bien plus rapide. Leur croissance est portée par le vieillissement de la population (la dépense maladie dépend étroitement de l’âge : 1251 € /an pour les 20-29 ans, 2,5 fois plus pour les sexagénaires et 5,5 fois plus pour les octogénaires), par le progrès technique et par une situation épidémiologique peu favorable : la France connaît ainsi une incidence importante des maladies chroniques, 20 % de la population relevant du dispositif des affections longues et durables et consommant 66 % des dépenses de soins prises en charge.
Le caractère « structurel » du déficit est donc patent et on ne peut le limiter par des économies qui ne s’attaquent pas à ses causes, d’autant que le contexte économique est morose, que la population active va stagner avant de diminuer et que l’augmentation de la productivité semble incertaine.
Que faire ?
D’abord récuser les idées reçues.
La conviction que l’augmentation de la participation financière des assurés les « responsabilise » dans leur consommation de soins (idée portée par François Bayrou comme par Catherine Vautrin, ministre de la santé jusqu’en octobre dernier) est contredite par toutes les études existantes, qui soulignent que l’accès aux soins des personnes défavorisées est pénalisé s’il devient trop coûteux et que les bénéficiaires de soins gratuits ne « surconsomment pas ». L’assurance maladie supporte à l’évidence des dépenses inutiles (médicaments, actes techniques ou hospitalisations évitables) mais c’est du fait des prescripteurs.
Pour autant, même si la France ne semble pas dépenser trop[1], la permanence du déficit de l’assurance maladie en France témoigne d’une discordance : la production de richesses par habitant est insuffisante pour financer ses dépenses, quand bien même celles-ci sont proches de celles des autres pays développés. Plutôt que de choisir d’emblée de réduire les prises en charge, il faut donc plutôt s’interroger sur l’existence de gaspillages et de dysfonctionnements du système et tenter de les réduire.
En mars 2025, F. Bayrou a demandé aux trois Haut-Conseils compétents (celui du financement de la protection sociale, celui de la famille, de l’enfance et de l’âge et le Haut-Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie) de réaliser un diagnostic sur les causes du déséquilibre financier et d’identifier les leviers d’action possibles. Le rapport (pour un redressement durable de la sécurité sociale) lui a été remis en juillet 2025. Dans le même esprit, la Cour des comptes a fait paraître une note sur l’ONDAM (Maîtriser la dépense tout en veillant à la qualité des soins, avril 2025), qui comporte des propositions structurelles qui se recoupent avec celles du rapport des Hauts conseils.
Sur le champ de la maladie, les propositions, énumérées et résumées ci-dessous appellent des commentaires :
1° Élaborer des prévisions financières pluriannuelles de retour à l’équilibre de la sécurité sociale, mais des prévisions documentées, pas des prévisions creuses comme celles qui figurent aujourd’hui dans les trajectoires financières transmises aux autorités européennes.
Cette proposition relève du bon sens mais nécessite une évolution fondamentale des méthodes utilisées dans l’élaboration des prévisions pluriannuelles des finances publiques par l’État, jusqu’ici dénuées de toute crédibilité, avec un contrôle beaucoup plus approfondi du Haut Conseil des finances publiques ; la perspective peut conduire à rendre contraignantes (sans pour autant les rendre absolument rigides) les lois de programmation des finances publiques (modification constitutionnelle) et, par ricochet, les LFSS.
2° Agir sur la qualité des emplois pour augmenter le taux d’emploi, notamment celui des seniors (santé au travail, pénibilité, évolution des pratiques managériales) ; lutter contre les arrêts de travail de longue durée.
La qualité de l’emploi n’est pas aujourd’hui une préoccupation des pouvoirs publics ou du MEDEF, qui comptent plutôt sur la contrainte (recul de l’âge de la retraite, dégradation des revenus de remplacement en cas de chômage) pour augmenter un taux d’emploi encore trop faible en France et prennent peu en compte l’usure au travail ; l’objectif implique une évolution fondamentale des politiques publiques comme une prise de conscience patronale.
3° Mettre en place une stratégie nationale de prévention des risques en santé, sachant que les dépenses de santé (notamment celles liées aux maladies chroniques et graves ou résultant de facteurs de risque comme l’alcool, le tabac, le manque d’exercice ou une mauvaise alimentation) reflètent la faiblesse de l’effort de prévention et expliquent les différences de morbidité constatées au niveau international au détriment de la France.
Le thème, déterminant, fait consensus ; toutefois, l’efficacité sur la durée des dispositifs de prévention proposés (incitation au dépistage, conseils moralisateurs, limitation de certaines publicités sur l’alimentation, voire taxes comportementales) est peu interrogée alors qu’elle est sans doute faible ; pour certaines populations défavorisées (les plus à risques), la prévention relève d’un accompagnement lourd et couteux ; il faut également interroger plus sérieusement qu’aujourd’hui l’efficacité du dispositif de prévention des accidents du travail et maladies professionnelle et de la lutte contre la pénibilité ; de même, la démarche de prévention serait plus crédible si elle s’intéressait davantage aux produits alimentaires (trop de sucre, trop de gras, trop d’aliments ultra-transformés), à la pollution environnementale, à la prévention des maladies mentales, à l’accès aux soins médicaux et au rôle des infirmiers dans le suivi des patients ; en définitive, cet axe d’action mérite d’être très sérieusement étudié, mais il est difficile, lourd, et sans doute coûteux à court terme bien avant d’être rentable.
4° Mieux lutter contre la fraude.
L’action fait consensus et doit être amplifiée ; l’enjeu de gain financier est sans doute assez limité, contrairement aux espoirs de la Cour des comptes.
5° Améliorer l’efficience de la prise en charge, lutter contre les gaspillages et les soins non pertinents, éviter les passages aux urgences non nécessaires et lutter contre les hospitalisations évitables, limiter le cloisonnement des soins, augmenter la chirurgie ambulatoire.
L’insistance sur le thème des gaspillages et des soins non pertinents est légitime mais la question est soulevée depuis des décennies et, si l’on met en valeur des réussites souvent temporaires, n’a jamais été vraiment résolue ; est en cause l’organisation même du système de soins, par définition cloisonné, même si les responsables politiques mettent en valeur des « expériences » (limitées et fragiles) de collaboration ; jouent aussi les difficultés d’accès aux soins de premier recours, la faible formation continue des médecins libéraux, le fonctionnement dégradé et expéditif des urgences ; sans réorganisation fondamentale du système de soins, les améliorations seront très difficiles à apporter. La question de la répartition de l’offre de soins sur le territoire est essentielle : dans les secteurs urbains riches en offre, les actes inutiles progressent, dans les secteurs déshérités, les solutions d’attente sont inadaptées et couteuses.
Quant à la volonté d’accroître l’efficience des établissements de santé, sa bonne prise en compte doit s’accompagner d’une politique claire sur le rôle de l’hôpital et ses moyens, indissociable d’une réflexion d’ensemble sur l’organisation du système de soins. Là aussi, l’accès aisé aux soins de premier recours comme le statut des praticiens hospitaliers publics sont essentiels.
6° Modifier l’organisation territoriale des établissements hospitaliers, fermer les services trop petits et développer les alternatives à l’hospitalisation, notamment à domicile
La question renvoie à la précédente : elle est posée depuis des années et jamais résolue.
7° Tarifer les médicaments et les actes médicaux au juste prix et éviter les rentes de situation, notamment de certains médecins
La question est posée depuis des années et jamais affrontée.
8° Pour modifier la séparation entre la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance complémentaire, passer à un système de bouclier tarifaire, avec une prise en charge à 100 % au-delà d’un certain montant de dépenses, sous condition de ressources ;
La proposition est très intéressante mais modifie fondamentalement le droit à remboursement et suscite des résistances fortes.
En définitive, la lecture des propositions contenues dans les rapports mentionnés ci-dessus est à la fois intéressante et frustrante : les suggestions de la Cour des comptes (« resserrer les prises en charge sur les prestations pertinentes », « engager des réformes d’efficience dans l’organisation de l’offre de soins » …) sont formulées sur le ton de l’évidence mais les obstacles à leur réalisation concrète sont méconnus. En réalité, le système de soins est mal fichu mais beaucoup d’acteurs préfèrent l’immobilisme à des bouleversements contraignants ; il est coûteux et, pour une part, peu efficient, mais il a ses profiteurs, qui le défendront ; il est insuffisamment préventif et redistributif (les plus modestes sont en plus mauvaise santé que les autres) mais ce constat n’a jamais conduit les pouvoirs publics à le réformer… Surtout tout sera long, alors que les décideurs sont pressés et voudraient des résultats rapides : la mise en œuvre d’une prévention plus efficace, le rétablissement de parcours de soins plus fluides, l’éventuelle création de dispensaires de proximité, l’institution d’une meilleure répartition des médecins, la création effective d’un corps d’infirmiers assurant des soins de suivi…tout prendra du temps.
En attendant ce grand soir, on peut toujours suivre le parcours chaotique du PLFSS 2026, qui peut très mal se terminer.
Pergama, le 10 novembre 2025
[1] Les dépenses de santé du pays, que ce soit en pourcentage du PIB ou en dépenses par habitant, ne sont pas aberrantes par rapport aux autres pays développés, même si la France est en haut du classement (2e ou 3e en Europe selon le cas)