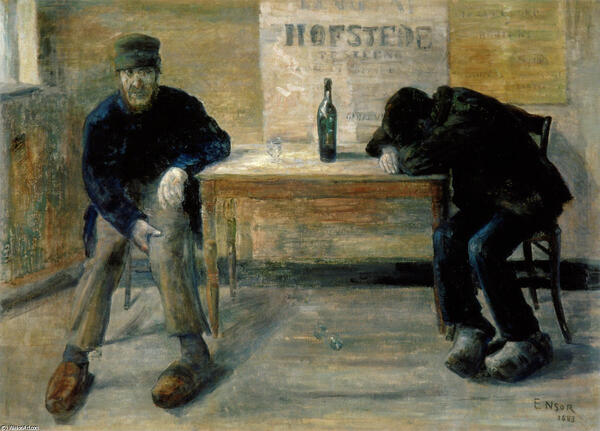Qu’attendent les Français de leurs responsables politiques?

Réduire la bureaucratie ou mettre à mal l’état de droit?
25 novembre 2024
L’Europe, union vieillie, divisée, en voie d’effacement?
23 décembre 2024À la parution, à la fin de novembre 2024, de l’édition 2024 de l’étude d’opinion Fractures françaises (vague 12), réalisée par Ipsos pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès, le CEVIPOF et l’Institut Montaigne, les journalistes ont souligné les résonnances dans l’opinion de la crise politique : la crise de confiance du peuple s’ajouterait à l’incapacité des responsables politiques de sortir du marasme actuel. Au-delà de la méfiance, se dégagent aussi d’une telle enquête les attentes de la population, auxquelles il faudra bien un jour répondre.
Une méfiance très ancienne
L’édition 2024 de Fractures françaises révèle une perception très sombre de la situation du pays : 87 % des Français le jugent en déclin. La confiance envers les institutions politiques subit, cette année, une baisse brutale, imputable à la dissolution, aux manœuvres du Président pour garder un pouvoir qui lui échappe, au constat de l’incapacité des partis à s’entendre à l’Assemblée nationale, à la découverte tardive d’une crise financière cachée, à l’inquiétude devant l’avenir : en 2 ans, la confiance envers les députés a baissé de 36 à 22 %, celle envers le Président de 41 à 26 %. Les élus sont jugés davantage corrompus (63 % au lieu de 57 %), intéressés par leurs intérêts personnels et non pas par celui des Français (83 % contre 71 %). 78 % des Français (contre 67 % deux ans auparavant) jugent que la démocratie fonctionne mal et ne se sentent pas représentés.
Pour autant, dans la première édition de Fractures françaises qui date de 2013, les conclusions étaient identiques. En 2013, les élus étaient déjà considérés comme corrompus (62 %), ne se préoccupant que de leurs intérêts propres (82 %), avec un système démocratique fonctionnant mal (72 %). L’on peut même remonter plus loin : selon un Baromètre politique du CEVIPOF d’avril 2007, 28 % des électeurs se définissaient comme « intégrés », 37 % se déclaraient avant tout « défiants » et 35 % comme hors système. Autre référence historique : c’est en 1991 que, pour la première fois, plus de 50 % des personnes interrogées pensent les hommes politiques corrompus.
Même s’il est risqué de mélanger les enquêtes (l’opinion peut varier, le contexte n’est pas le même), force est de constater qu’elles vont toutes dans le même sens : selon l’enquête internationale IPSOS L’État de la démocratie (octobre 2024), seulement 6 % des Français pensent que les élus tiennent leurs promesses. Plus inquiétant encore, les responsables politiques sont accusés de partialité sociale : 57 % des Français pensent que « les politiques privilégient les besoins des riches et des puissants » sans se préoccuper beaucoup des autres catégories.
Ce qui frappe donc, ce n’est pas la nouveauté du constat de 2024, c’est le caractère de « marronnier » du diagnostic : depuis 20 ou 30 ans au moins, la France va mal, elle met en cause son système et son personnel politiques et il ne se passe rien, que des promesses de renouveau sans lendemain, comme lors de la présidentielle de 2017.
Une méfiance justifiée
Les opinions émises ne sont pas toutes exactes : la corruption des élus est certes mal combattue en France mais elle n’atteint en aucun cas les sommets indiqués. Certains élus se préoccupent de l’intérêt des Français et la population le reconnaît, s’agissant, notamment, des maires.
En revanche, tous les bilans montrent que, de fait, les promesses électorales (au demeurant floues, mal chiffrées voire irréalistes) ne sont pas tenues. Mais davantage encore que ce manquement, c’est la figure du monarque républicain qui cristallise l’exaspération, surtout depuis N. Sarkozy, le premier Président « responsable de tout », avec son histrionisme et ses déclarations agressives et clivantes. Est venu ensuite un Président socialiste qui, à l’inverse de ses engagements, a joué tout seul avec la fiscalité et les lois sociales et s’est montré incapable de résister à une gestion sécuritaire du terrorisme.
Désormais, ce qui exaspère une grande part des Français, c’est le Jupiter impérieux hostile aux corps intermédiaires, qui choisit des premiers ministres dépourvus de poids politique et gouverne autant qu’il préside, sans contrepoids puisque le Parlement, au moins jusqu’en 2022, n’a été qu’une institution obéissante. Survenue à la suite d’une décision inique consistant, dans le même budget, à alléger les impôts des entreprises et des catégories aisées et à alourdir la facture énergétique et de carburants au détriment, pour l’essentiel, des catégories modestes, la crise des Gilets jaunes n’a pas seulement été une révolte sociale. Elle a révélé la détestation des classes populaires pour un pouvoir jugé lointain et méprisant, sorti des grandes écoles, qui fait la leçon sans vergogne à ceux qui ont du mal à vivre et qui ne les écoute pas : d’où les propositions répétées de référendum d’initiative populaire qui rendrait à la voix du peuple sa puissance. Ce sentiment d’être méprisé et tenu pour rien explique pour une large part le basculement à droite des ouvriers. Le rejet va bien au-delà : il touche aussi les intellectuels et les classes moyennes.
Aujourd’hui, la parole politique est dépréciée : l’abstention monte même aux élections présidentielles, comme s’il n’y avait plus d’enjeu ; personne ne croit plus que la France ait travaillé à redresser ses finances publiques depuis 2017 ou engagé une politique efficace pour améliorer l’école ou l’hôpital, encore moins (c’était pourtant inscrit dans le programme d’E. Macron en 2022) qu’ait été mis en place une planification écologique ; le soupçon de manœuvres de la classe politique à des fins personnelles est au plus haut en 2024, la décision de dissolution étant apparue comme un pari égoïste lancé par le Président par orgueil personnel et volonté de toute-puissance. E. Macron l’a reconnu, en privé : « Je leur ai envoyé une grenade dégoupillée dans les jambes, maintenant on va voir comment ils vont s’en sortir ». C’est le pays qui en subit les conséquences, tout comme il subit celles de la baisse systématique des impôts, dogme déraisonnable imposé par le Président et maintenu contre toute raison pendant une crise sanitaire puis économique. C’est le pays qui a subi une réforme des retraites imposée de force ou la flopée des recours à un article 49-3 devenu un symbole d’arbitraire.
Que demandent les Français ?
Les premières préoccupations exprimées sont très concrètes, sur fond de diagnostic de déclin et de l’expression de difficultés financières : Fractures françaises évoque en premier le pouvoir d’achat, devant d’autres soucis de vie quotidienne, santé, délinquance, sécurité et retraites. Il existe à l’évidence une demande de protection, de sécurité matérielle et d’accès à des droits de base, mais aussi d’assurance sur l’avenir, demande qui n’est satisfaite : les politiques doivent aider, garantir, s’occuper de l’avenir.
Toutefois, une demande est exprimée juste après celle qui concerne le pouvoir d’achat, avant la délinquance, l’immigration, la santé, c’est la protection de l’environnement, qui recouvre à la fois la lutte contre le dérèglement climatique et la protection de la biodiversité : 78 % des Français sont préoccupés par le changement climatique, ce qui témoigne également d’une forte inquiétude à laquelle les politiques ne répondent pas.
Quant aux demandes plus qualitatives, elles portent sur la volonté de compter, d’être respecté, écouté.
De manière plus fondamentale encore, loin d’être des « Gaulois réfractaires », les Français expriment dans Fractures françaises une forte confiance envers des institutions séparables du pouvoir politique : les entreprises (surtout les petites et moyennes), les institutions qui représentent l’ordre (armée, police) les scientifiques (80 %), l’école (70 %), même si une courte majorité (52 %) reproche à celle-ci de ne pas garantir à tous les mêmes chances.
De même, comme l’analyse B. Teinturier dans un article récent (Fractures françaises, des angoisses de disparition mais pas de décivilisation, Le Monde, 2 décembre 2024), leur rejet de la violence, leur reconnaissance de l’existence du racisme et de l’antisémitisme, leur approche des mesures prises sur les droits des femmes traduisent un système de valeurs partagées : la valorisation de l’autorité doit être appréciée dans ce contexte. Par ailleurs, les perceptions négatives sur l’immigration restent stables, dans une année pourtant marquée par la colère, et la part des Français jugeant l’immigration nécessaire à l’économie, certes minoritaire (44 %), augmente nettement. L’année 2024 a été marquée par la question de la régularisation des immigrés qui travaillent. Or, d’autres enquêtes montrent que dès lors qu’un lien est établi entre l’immigré et le travail, les perceptions sur l’immigration s’améliorent : c’est peut-être aujourd’hui le cas.
Enfin, la confiance dans la démocratie (65 %) est stable, même si elle a été meilleure (76 % il y a 10 ans) et même si elle est plutôt sur une pente négative. On a beaucoup glosé sur les 35 % de Français qui jugent qu’un autre régime pourrait être « aussi bon » : mais la question est ambiguë et encourage les réponses irréfléchies. Quand la demande est plus précise, la réponse l’est aussi : dans l’enquête IPSOS de mars 2023 La société idéale de demain aux yeux des Français, on mesure d’abord qu’il existe de vifs débats sur le type de démocratie souhaité (représentative, participative), ensuite que le rejet de la norme démocratique est très minoritaire (7 % à 9 %).
Surtout, le consensus est net (63 %) sur la solidarité et la redistribution (« prendre aux riches pour donner aux pauvres ») : depuis 10 ans, il n’est jamais descendu en dessous de 56 %. Il est vrai que parallèlement, il existe un rejet de l’assistanat (56 %), même s’il est en baisse : le message est sans doute que la valeur travail doit être conciliée avec la redistribution.
Il existe donc un socle commun d’attentes. Ce n’est pas sans doute un hasard si, déjà, une note d’août 2021 de la Fondation Jean Jaurès, Ce qui rassemble les Français, mentionnait, parmi les consensus, la justice sociale et la réduction des inégalités de revenus, l’articulation entre démocratie représentative et démocratie participative, une demande d’action forte sur l’environnement…et l’application stricte de la laïcité, sujet non abordé dans Fractures françaises.
Au regard des attentes des Français, quel bilan de l’épisode Barnier ?
La conclusion est évidente, l’épisode Barnier est calamiteux : il contrevient aux principes démocratiques, il inquiète, il n’aborde aucun des domaines susceptibles de mobiliser les personnes.
Ce premier ministre, qui ne doit sa nomination qu’au fait du Prince, était illégitime par définition : or, il n’a pas pris la peine de se construire une légitimité en élaborant et en présentant un programme d’action, même de court terme ; il n’a négocié ses orientations avec aucune des autres forces politiques, sans doute pas même avec ses alliés supposés, ni posé dès le départ, avec autorité, ses propres lignes rouges ; dans une période d’insécurité et de flottement, il a présenté son projet de budget comme imparfait (de fait il l’était) en laissant libre chacun de l’amender, sans le défendre ; ce budget n’était centré que sur le rétablissement des finances publiques et la limitation du déficit, alors même que chacun sait qu’une rigueur excessive ne permettait pas d’atteindre les objectifs visés et qu’il aurait mieux valu planifier le rétablissement sur 7 à 10 ans ; la seule perspective assumée de politique publique a été une nième loi de durcissement des règles sur l’immigration et aucune politique n’était définie sur la santé, l’école, l’environnement, la réduction des inégalités, comme si les finances dominaient tout ; enfin les chefs de partis ne pensaient manifestement qu’à se protéger pour les présidentielles à venir et ont manqué à leur engagement de soutien ; une majorité hétéroclite a voté une censure du gouvernement sans avoir aucune idée de ce qui allait se passer et dans l’indifférence des conséquences, comme si la vacance du pouvoir ne comptait pas.
Sur le plus long terme, quelles perspectives ?
La demande de changement existe dans l’opinion depuis longtemps. En 2020, le Pew Research Center, un Centre de recherche américain qui réalise des enquêtes d’opinion, a révélé que les 2/3 des adultes, en France et aux USA, estimaient que leur système politique avait besoin d’un changement majeur, plus qu’au Royaume-Uni (la moitié), plus qu’en Allemagne (4 sur 10). L’enquête mentionnée ci-dessus sur la société idéale le confirme : 59 % des Français déclarent vouloir un changement en profondeur ou radical. Les Français jugent que leurs attentes ne seront écoutées que si, d’une manière ou d’une autre, le système politique évolue.
Le changement de système est aussi jugé inévitable par les politistes, pour d’autres raisons : ils relient la crise actuelle, née des législatives de 2022, à la disparition du fait majoritaire qui a accompagné le régime présidentiel depuis 1962 : dès lors que les partis s’émiettent et qu’il existe au moins 3 blocs sinon 4, le Président ne peut plus s’appuyer de manière certaine sur un parti majoritaire et le pays peut aller de crise en crise. Les politistes voient dans la montée des partis protestataires le refus de perpétuer un régime présidentiel et une omnipotence qui ne correspondent plus aux évolutions de la société.
Pour autant, les responsables politiques paraissent ne pas prendre en considération ces perspectives : ceux qui veulent aujourd’hui faire partir le Président veulent prendre sa place et se projettent sur l’exercice d’un mode d’autorité identique. Alors que la question du choix entre un modèle parlementaire et un modèle présidentiel ou celle des modifications souhaitables pour rendre la démocratie plus participative sont latentes dans l’opinion, évoquées par les politistes, présentes sur les plateaux, elles ne mobilisent absolument pas les décideurs.
Il est vrai que, s’agissant du choix d’un modèle parlementaire, un universitaire et responsable politique belge, Paul Magnette, et un politiste, Rémi Lefèbvre, en ont récemment souligné les difficultés. Les conditions de réussite ne paraissent pas réunies : acceptation d’une moindre personnalisation du pouvoir, décisions davantage partagées et encadrées par des engagements publics préalables que l’on se doit de respecter, pratique de la négociation et du compromis, existence de partis solides aptes à mobiliser et à mener un travail collectif, choix d’un mode de scrutin différent avec une acceptation du risque d’éparpillement. Pour l’instant, en France, l’élection présidentielle écrase tout, le Président s’inscrit dans une recherche de dialogue personnel avec les électeurs, la culture majoritaire prédomine encore et celui qui a la majorité pense qu’il peut librement imposer son programme. La voie est possible mais difficile.
Quant aux perspectives tendant à infléchir le pouvoir présidentiel actuel en ayant davantage recours à une démocratie participative (pratique du référendum, assemblées citoyennes), les parlementaires ont à de multiples reprises montré leur opposition. Le seul parti qui promeut aujourd’hui le référendum est le Rassemblement national, avec le but avoué de contourner les principes fondamentaux de la déclaration des droits de 1789.
Le risque est donc fort que la classe politique continue d’ignorer les demandes de la société mais aussi qu’elle ne parvienne même pas à adapter le système politique au nouveau contexte multi-partisan. Il reste deux ans pour comprendre l’urgence du changement.
Pergama, le 9 décembre 2024
.